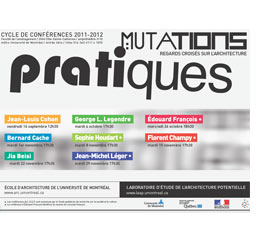« Le logement collectif : architecture remarquable et critères d'usage », conférence à l'École d'architecture de l'Université de Montréal, 29 nov 2011
Texte intégral
Je remercie très sincèrement Georges Adamczyk de m'avoir invité de si loin et de me faire confiance pour vous communiquer mon point de vue sur l’architecture du logement social dans ses relations avec les usages. Je propose de vous parler d'une activité de recherche, qui est aussi une activité d'expertise, dans la mesure où il s'agit d'évaluer l'architecture de l'habitat par l'usage. Je vais discuter à la fois de l'utilité et de l'efficacité de cette évaluation en prenant des exemples d’opérations de logement, certaines célèbres, connues sans doute par d'entre vous qui sont les plus familiers de la France, et d’autres plus confidentielles.
Mais d'abord, pour comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut passer par un – très rapide, je vous rassure – rappel de la situation française du logement social et de son architecture. La France n'est ni l'Angleterre ni l'Allemagne ni les Pays-Bas mais elle a tout de même depuis plus de cent ans (depuis 1894 exactement) une politique et une production de logement social que l'on peut découper en trois périodes. La première est celle des HBM, qui, du point de vue de l'architecture, a été très influencée par l'Angleterre, par ses cités-jardins comme par ses immeubles urbains collectifs.
Ensuite, il y a une période de dix ans de vide, parce que la France est occupée, puis en partie détruite, davantage d'ailleurs par les Alliés (les Anglais et les Américains, pas les Canadiens !) que par les Allemands, destructions importantes qui expliquent que la Reconstruction (1945-1955 ou 1940-1955) reconstruise ce qui a été détruit, c'est à dire reconstruise des immeubles appartenant à des propriétaires privés qui, traumatisés par la guerre, demandent une architecture traditionnelle plutôt que des formes contemporaines (voir le cas fameux de St-Dié)
Mais la plupart des architectes étant modernistes, l’architecture de la Reconstruction est un savant compromis entre tradition et modernité, et c'est aujourd'hui une architecture qui est réévaluée après avoir été méprisée par les architectes de l’après-reconstruction.
Ensuite, le début des années 50 voit se chevaucher la fin de la Reconstruction et le début des grands ensembles, période que l'on fixe de 1953 à 1973, période de vingt années seulement mais pendant laquelle seront construits quatre millions de logement sociaux sous une forme urbaine issue de la charte d'Athènes, quatre millions de logement qui pèsent encore extrêmement lourd dans le quotidien et dans l'imaginaire des Français puisque, en partie à tort, ils sont identifiés comme étant la forme urbaine dans laquelle sont logés les pauvres et les immigrés, et dans laquelle il y a régulièrement des émeutes. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui....
Le glas de la fin des grands ensembles a été sonné en 1973 par le ministre de l’Équipement, Olivier Guichard, qui prenait tout simplement en compte que cet urbanisme de masse ne répondait plus aux conditions économiques et sociales des Français, lesquels avaient depuis toujours exprimé une préférence pour la maison individuelle détachée.
On sait bien aujourd'hui que le choix de construire les grands ensembles de logements collectifs n'est pas d'ordre économique mais idéologique, la technostructure d’État ayant fait alliance avec les architectes pour construire du collectif, comme si la France se sentait coupable d'entrer dans la modernité seulement en 1953, alors que l'Allemagne y était entrée trente ans plus tôt.
J'en arrive à la 3e période, qui commence en 1971, période dans laquelle nous sommes toujours, depuis quarante ans donc, évidemment c'est long quarante ans et je pourrais découper différemment, mais à l'échelle du siècle, c'est un découpage suffisant.
Que s’est-il passé en 1971, deux ans donc avant la fin officielle des GE ? C'est la fondation du Plan Construction, agence de l’État toujours en action, de même que sont toujours en action ses programmes expérimentaux, son concours Pan devenu Europan et ses programmes de recherche.
Car c'est à partir de 1971, années où apparait aussi le postmodernisme, que l'architecture du logement s'est diversifiée, au même titre que l'architecture des équipements. Ce qui distingue l'architecture européenne de l'architecture nord-américaine, c'est notamment qu'en Europe, l'architecture s'empare du logement social – à moins que ce ne soit le logement social qui soit la proie de l'architecture.
Parce que l'expérimentation est plus facile dans le logement social, où les habitants sont captifs, au sens où le logement social se situe en dehors du marché du logement, ce qui pose de sérieuses questions sur l'usage et les goûts que je vais maintenant aborder.
Si j'ai donc dû faire ce grand détour historique, c'est pour vous montrer d'où nous venons, du traumatisme de la guerre, de la crise quantitative du logement, puis de la crise tellement endémique des grands ensembles depuis quarante ans qu'elle n'est plus une « crise », puis du retournement postmoderne, dont le formalisme a laissé depuis dix ans la place à l'écologisme qui donne lieu à des excès réglementaires, mais qui est la source d'un renouvellement « durable », au sens de renouvellement qui durera et qui est à l’origine d'une architecture très inventive.
En France, le secteur expérimental du logement explique que l'évaluation (la POE) soit plus forte dans le logement que dans les bureaux et les équipements, alors que chez vous, c'est l'inverse.
A la différence du maître d'ouvrage privé, qui s'inscrit dans un marché concurrentiel, le maître d’ouvrage social, qui est donc hors marché, n'est pas tenu de répondre à la demande esthétique et pratique des habitants. C'est ce qui permet l'expérimentation, en France comme dans les autres pays européens, le dégagement de la demande des habitants laissant aux architectes libre cours à la création, avec bien sûr le risque de dérives de logements qui seront considérées comme des événements du point de vue de la critique architecturale mais qui peuvent être difficiles à habiter. La tension entre la demande populaire et la demande culturelle, qui relèvent de registres opposés est ainsi la grande question de l'architecture du logement. Si certains pensent que le logement n'a pas à être l'objet d'expérimentations, parce que les habitants sont foncièrement conservateurs, d'autres, dont je suis, pensent que l'architecture, y compris celle du logement, est un bien culturel, et que certaines inventions typologiques ont marqué non seulement l'histoire de l'architecture du XXe siècle, mais ont marqué positivement la vie quotidienne de leurs occupants qui apprécient de vivre dans des espaces différents, avec une autre spatialité, une autre esthétique et une autre fonctionnalité. Tout ce que je vais vous montrer appartient à la sphère créative de l'architecture et non pas aux règles de la prudence et de la répétition.
Parmi tout ce que j’ai de disponible dans ma valise de références, j’ai choisi cinq exemples de réalisations.
1° Les Anglo-saxons nomment « Post-occupancy evaluation » j’y reviendrai tout à l’heure – ce que j’appelle plutôt en français « évaluation socio-architecturale », en reprenant simplement le titre de l’ouvrage de Philippe Boudon, paru en 1969, qui s’appelait Pessac de Le Corbusier, étude socio-architecturale, car l’enquête de Boudon reste en France la grande référence de la critique de l’architecture par ses usagers. Dans son livre, Philippe Boudon révélait les transformations effectuées par les habitants des petites maisons de Le Corbusier pour les rendre conformes à leur goût esthétique et à leurs manières d'habiter. Le plus étonnant dans l’expérience de Pessac, c’est qu’elle représente à elle seule une véritable leçon de la séquence production/réception de l’architecture de l’habitat sur trois quarts de siècle.
En effet, dans une première phase, Le Corbusier réalise en 1925 ce petit projet pour des ouvriers de la périphérie de Bordeaux. Puis, avant et après la deuxième guerre mondiale, au cours de laquelle certaines maisons sont endommagées, les habitants les transforment en supprimant les fenêtres en longueur ou en ajoutant des éléments décoratifs : c’est encore la situation à la fin des années 1960 quand Philippe Boudon réalise son enquête.
Enfin, Le Corbusier devient progressivement un monstre sacré, toute son œuvre devient sacrée elle aussi et une procédure règlementaire originale oblige désormais les nouveaux acquéreurs à restaurer les maisons dans leur état d’origine, ce qui revient bien souvent à les reconstruire tant elles avaient été mal construites. En 1963, le Corbusier avait même déclaré qu’il avait construit ces maisons pour une durée de 30 ans – il savait bien que le procédé de construction par béton projeté était défectueux – et que l’on pouvait donc les démolir maintenant.
Près d’un siècle plus tard, on les restaure donc à grands frais, car il y a aujourd’hui un certain nombre de gens à Bordeaux - qui ne sont pas tous des architectes - qui dépensent beaucoup d’argent pour habiter une maison de Le Corbusier. Pessac est ainsi devenu un curieux exemple de patrimonialisation d’œuvre du XXe siècle, quitte à ce que la restauration implique parfois de tout refaire, de reconstruire presque à l’identique et de créer bien sûr de nouvelles cuisines et de nouvelles salles de bains. Ceci pose la question de l’authenticité dans la conservation de l’architecture de l’habitat qui est un vrai débat pour l’architecture des siècles précédents, bien sûr mais qui l’est donc aussi pour l’architecture du XXe siècle.
2° Le second exemple est une opération parmi les plus célèbres de Jean Nouvel : son opération de logements sociaux à Nîmes, qu’il a construite entre 1985 et 1987, et qui est à rapprocher des Unités d’habitation de Le Corbusier parce que Jean Nouvel y réinterprète leurs pilotis, la double hauteur de leurs logement et le dispositif d'ouverture complète des loggias.
Ce qui caractérise Nemausus, c’est le pari de Jean Nouvel de construire des logements plus grands (+ 40 % de superficie en moyenne) pour le même prix que les opérations normalisées, mais en offrant une architecture pauvre, dépouillée (béton brut, pas de revêtements muraux, matériaux industriels tels que le métal galvanisé). Évidemment, l’économie constructive est surtout pour Nouvel le prétexte pour une esthétique industrielle, de pseudo-lofts brutalistes, mais c’était déjà le cas pour les architectes modernes des années 1920, qui proposaient une architecture pure, radicale, autant par idéologie contre l’ornement que pas nécessité économique de construire pour le plus grand nombre.
L’esthétique industrielle de Jean Nouvel choque certes de nombreux habitants (il s’agit de logements sociaux locatifs) mais il y a aussi des habitants qui sont séduits par les grands volumes, les grandes terrasses et une expression de modernité qui est toujours la même dans ce genre d’opérations en logement social – on le reverra tout à l’heure avec la cité Manifeste de Mulhouse. C'est-à-dire que les habitants des HLM sont valorisés par ces architectures qui sont l’objet de polémiques mais dont on parle dans les médias, les revues de décoration, etc. En somme, habiter un logement non ordinaire est un moyen de dépasser la condition du salarié ordinaire qui habite en HLM parce qu’il n’a pas les moyens d’habiter un appartement en centre-ville ou une petite maison en périphérie.
Bref, les grandes surfaces de Nemausus sont certes bonnes à prendre, mais on peut regretter que les plans des logements se contentent d’agrandir le plan-type sans offrir une diversification des espaces, sachant que ce que les habitants demandent, ce n’est pas tant des mètres carrés en plus que des espaces spécifiques : lingerie, bureau, pièce de bricolage, deuxième salle de bains, chambre d’ami, tous espaces qui sont difficilement aménageables à Nemausus.
3° Au même moment où Jean Nouvel construisait Nemausus, Yves Lion et François Leclercq dessinaient en 1984 le concept de Domus Demain, qui a été beaucoup publié et discuté dans les écoles d'architecture, et qui a donné lieu à une unique application dans un programme de logements sociaux situé à Villejuif dans la banlieue de Paris.
Le projet est très riche, car, comme si la bande active ne suffisait pas, Yves Lion a voulu qu'il soit aussi un immeuble-villas, pour rester sur Le Corbusier, qui demeure pour les Français une référence majeure (ils espèrent que les œuvres de Le Corbusier en France et en Suisse seront inscrites cette année par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial).
Une des intentions de Domus demain est de supprimer la salle de bains commune et de mettre à disposition de chacun une salle de bains dans sa chambre, devant la fenêtre, dans une « bande active ». L'enquête a révélé que l'usage convenait très bien aux enfants (sauf dans le cas où un garçon et une fille partageaient la même chambre) mais était refusé par les couples qui avaient l'impression de dormir dans une salle de bains et répugnaient à se montrer nus devant leur conjoint. Exit donc Domus demain, Yves Lion ne l'a plus jamais appliqué mais, par exemple, le Japonais Yamamoto (qui avait visité Villejuif avec Jean-Louis Cohen) l'a réalisé plus tard dans un projet à Tokyo.
En revanche, dans une opération ultérieure réalisée à Marne la Vallée, où il avait initialement prévu des logements avec bande active, Yves Lion a su faire évoluer le plan en proposant des salles de bains prises en sandwich entre deux chambres, ce que permet une grande trame de 7,20 m. Et ces logements, qui ont d’autres qualités, par exemple une circulation en 8 dans l’appartement, plaisent beaucoup à leurs occupants.
4° Zac Dauphinot
Il s’agit là de la réalisation d’un projet Europan de 122 logements, dont les architectes sont allemands et qui avaient proposé un type de logements intermédiaires assorti d’un système de récupération des eaux pluviales, ainsi que cela se pratique couramment en Allemagne mais vers lequel les Français se tournent depuis peu, et dont la Ville de Reims n’a pas voulu à ce moment-là. C’est donc un projet qui n’a rien d’écologique, qui est même très minéral, à comparer avec le quartier Vauban de Fribourg, mais qui, en revanche, est très innovant sur le plan des typologies de logements, puisqu’il y a 30 types de logements différents pour un total de 120 logements.
5° Cité Manifeste
Un autre tandem d'architectes qui fait beaucoup parler de lui depuis quinze ans est celui d'Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Ceux-ci ont participé en 2003-2005, avec Jean Nouvel, Shigerun Ban, Duncan Lewis et Mathieu Poitevin, à la Cité Manifeste, à Mulhouse, qui est une cité expérimentale voulue par son directeur à l'occasion des 150 ans d'une société qui a construit en 1853 une des premières cités ouvrières de France.
Vous connaissez Lacaton & Vassal, dont on moque souvent l'emploi qu'ils font du polycarbonate, qu'ils utilisent dans des serres, et vous connaissez aussi la manière dont, comme Jean Nouvel, ils dessinent des lofts, de grandes surfaces brutes, non finies, la grande surface étant permise par l'économie réalisée sur les matériaux. J'ai absolument voulu réaliser l'évaluation de cet ensemble, pour, là aussi, mettre fin à l'opinion du pour et du contre, les architectes étant de manière générale les plus critiques envers leurs confrères.
De même que pour les Unités d’habitation de Le Corbusier, pour Nemausus ou pour la bande active à Villejuif, il est sûr que les logements de la cité Manifeste ne sont pas faits pour tout le monde, qu’ils ont besoin d'un public spécifique. Si l'on pense au logement de masse, au logement pour tous, il est certain que ces architectures ne conviennent pas. Toutefois, bien que la pénurie de logements persiste en France, ce pays peut se permettre des expérimentations, à condition que les habitants puissent les choisir.
La leçon des innovations de Lacaton & Vassal à Mulhouse, comme la leçon des autres expériences est que, contrairement à ce que l'on dit, elles ne plaisent pas seulement aux « bobos », aux artistes et intellectuels en quête de distinction. Elles plaisent aussi à des habitants de culture populaire que rien ne prédisposait à aimer le béton brut et le polycarbonate. Il n'est d'ailleurs pas sûr que beaucoup de gens aiment le béton brut et le polycarbonate, mais ils aiment les grandes surfaces proposées et ils aiment se sentir et se représenter comme différents par rapport à la banalité de leur condition sociale. Cette architecture leur donne le moyen de construire une différence identitaire, de réaliser une création, alors que leur vie professionnelle est ordinaire. Pourquoi pas ? Ces habitants tirent à leur profit ce que leur offrent le maître d'ouvrage et l'architecte. C'est la définition de l'appropriation.
Les quelques exemples que je vous ai montrés appartiennent au corpus de l’architecture remarquable (au sens premier du terme) dont tous les atlas de plans qui ont été publiés depuis dix ans révèlent l’extraordinaire richesse, malgré les contraintes règlementaires de plus en plus fortes que tous les pays subissent. S’il s’agissait d’enrichir ce corpus mais de contraindre, d’assujettir l’usager des formes inhabitables, la contribution à la seule histoire de l’architecture serait bien sûr inacceptable. Ce n’est pas le cas, ces architectures ne sont pas destinées à tout le monde, mais, je le répète elles donnent du bonheur à des usagers, qui ne trouveraient pas l’équivalent dans le marché privé.
Ce qui est regrettable, en revanche, c’est que les erreurs de conception et de réalisation, constatés par les études d’évaluation, ne soient pas corrigés dans des projets ultérieurs, ce qui est le principe du feed-back. Il faut désormais demander à l'évaluation socio-architecturale qu'elle s'inscrive dans un vrai processus de retours sur expérience activé par une institution, à condition que celle-ci encadre des processus expérimentaux sur le long terme, de manière à ce que les architectes et les maîtres d'ouvrage qui souscriraient à de tels programmes puissent progresser dans la dynamique essai/erreur qui est celle de la plupart des processus industriels.