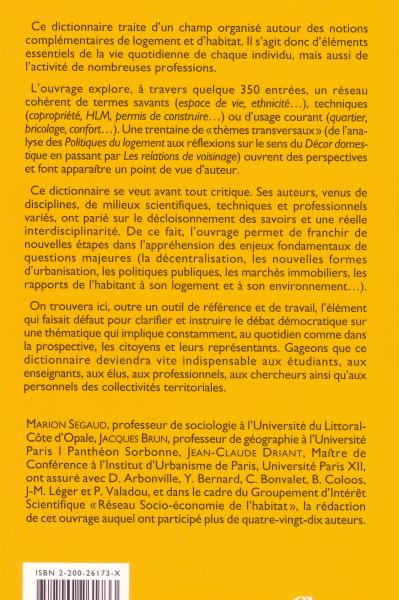« Expérimentation architecturale », in Marion Segaud, Jacques Brun, Jean-Claude Driant (dir.), Dictionnaire de l’habitat et du logement, Paris, Armand Colin, 2003, p. 53-54 et 163-165.
Texte intégral de l'article (entrée du Dictionnaire)
En 1903, Auguste Perret inaugure grâce à l'ingénieur Hennebique l'emploi du béton armé dans l'habitation en soumettant la construction à la distribution (rue Franklin, Paris-XVIe). En 1945, le ministre Raoul Dautry commande directement à Le Corbusier l'indépassable Unité d'habitation de Marseille. De Marseille à Berlin, la qualité architecturale des cinq unités d'habitation construites successivement par Le Corbusier va en décroissant ; son œuvre est toutefois poursuivie par les représentants du courant « brutaliste ", qui, avec des personnalités aussi différentes que Paul Chemetov, Roland Simounet ou Jean Renaudie, multiplie des essais passionnés dans le paysage dévasté de la banlieue parisienne. Entre 1949 et 1956, le constructeur Jean Prouvé bâtit plusieurs maisons prototypes (maison « Les jours meilleurs », maisons de Meudon) dont aucune ne sera produite en série, même si le nom de Prouvé restera associé à de très nombreuses expériences constructives avec l'aluminium. En 1955, les architectes Viret et Dumont réunissent toutes les pièces humides autour d'une gaine centrale visitable par un escalier intérieur, dispositif ingénieux restée sans lendemain (rue des Panoyaux, Paris-XXe). En 1987, à Nîmes, Jean Nouvel livre ses logements expérimentaux les plus fameux, deuxièmes d'une série de quatre destinés à démontrer qu'il est possible de réaliser des appartements plus grands pour moins cher. Les difficultés d'usage rencontrées par les habitants de Nemausus sont-elles dues à la singularité des logements ou à la carence du gestionnaire ? Certains observateurs voudraient vendre ces immeubles au poids de leur ferraille, d'autres les classer au titre de monument historique. Ces exemples pris parmi des dizaines d'autres constituent quelques-unes des pages de l'histoire de l'architecture du logement. Histoire qui se confond avec les expériences formant la sédimentation des savoirs caractéristique de toute civilisation. Mais de quelle expérience s'agit-il donc ?
Quand, la première guerre mondiale à peine éteinte, plasticiens, architectes et ingénieurs positionnent l'architecture entre l'art et l'industrie, ils remettent l'art en cause et attendent beaucoup de l'industrie et de la science. « Expérience » et « expérimentation » sont dès lors utilisées dans les deux sens de l'experentia latine, à la fois enrichissement de la connaissance par la pratique et épreuve, essai, provocation d'un phénomène pour l'étudier, ce qui était déjà le sens adopté par les premiers scientifiques du XVIIe siècle, avant d'être consacré par Claude Bernard. Le mot convenant aussi bien à la pratique artistique qu'à l'observation scientifique, les architectes n'en abusent donc pas lorsqu'ils nomment « expérience " leur quête de solutions nouvelles. Ce sont les discours sur l'« expérience des grands ensembles " ou le « laboratoire des villes nouvelles », appuyés sur le souci des institutions à la validation et à l'évaluation de leurs politiques d'innovation, qui font penser que l'expérimentation architecturale et urbaine se situe du côté de la scientificité, alors que ses laboratoires sont généralement dépourvus d'observateurs et de retour aux hypothèses.
Le cas des grands ensembles illustre bien la complexité des phénomènes à observer, quand le caractère pathogène de cette forme urbaine est l'objet de vifs débats, la forme n'étant qu'un déterminant, aux côtés de la situation urbaine, du statut social des habitants, etc. Il en va de même pour des réalisations expérimentales (REX), qui, avec les Programmes architecture nouvelle (PAN) et les modèles-innovation, ont représenté les principales actions du Plan Construction, agence interministérielle créée en 1971 pour soutenir la recherche, l'innovation et l’expérimentation dans le logement, ainsi que pour encourager la participation des habitants. Les modèles-innovation associaient architecte, bureau d’études et entreprise générale, afin de renouveler les formes et les techniques de construction héritées de la Charte d'Athènes tout en prétendant bâtir, comme toujours, « plus et mieux », pour répondre à une demande que l'on croyait toujours forte (550 000 logements construits en 1973, dernier pic avant la crise). Ils échouèrent dans leur ambition d'ouvrir l'industrialisation et devinrent très vite caducs avec la chute de la dimension des chantiers de logements collectifs, désormais fortement concurrencés par l'habitat pavillonnaire.
Les incitations du Plan Construction (Plan Urbanisme Construction Architecture depuis 1998) s'inscrivent dans la tradition de l'exception culturelle française, où l'Etat donne des coups de pouce destinés à moderniser les méthodes et l'appareil de production du bâtiment et à l'adapter à la demande sociale. L'implication de l'Etat est en effet sensible dès la première reconstruction (1940-1945) lors du lancement des premiers concours destinés à rationaliser la production d'éléments (tels les blocs-eaux, groupant cuisine, salle d'eau et WC) qui inspireront ceux de la seconde reconstruction (après 1945) et, surtout, ceux de la standardisation généralisée à partir des années 1950. Le retournement des années 1970 ne doit pas faire oublier que les expérimentations les plus décisives avaient été entreprises pendant les vingt-cinq années précédentes, de la reconstruction aux grands ensembles. Les concours du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme de 1947 et 1949 et le concours pour la cité Rotterdam à Strasbourg (1951) avaient été l'occasion des premières mises au point de procédés de préfabrication, les uns abandonnés, les autres perfectionnés par la suite, consacrant ainsi la suprématie du béton et, en corollaire, celle du logement collectif. La recherche de l'efficacité et de la rentabilité constructive n'était d'ailleurs pas indépendante d'une préoccupation pour les modes d'habiter, l'amélioration du confort (surface, lumière, chauffage, bains, matériaux) n'étant pas dissociée de celle de l'intimité (apparition de la bi-partition jour/nuit). Il est sûr en revanche que les habitants n'ont pas été consultés pour décider du glissement définitif de la salle de bains vers l'intérieur du logement ou de l'obligation de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), déjà préparée dans les années cinquante par les gaines dites « shuntées ». L'opposition populaire à la salle de bains aveugle et à la VMC, généralisées à des millions d'exemplaires, est un exemple des limites de l'expérimentation dans le logement, dont la technicité et l'humanité progressent dans une interaction boiteuse entre les tests des architectes et des ingénieurs, l'écoute mal entendante des habitants et les textes des normalisateurs censés œuvrer pour le bien public.
Aujourd'hui, l'expérimentation marque le pas. La baisse du logement collectif, la recherche du consensus et la fin des engagements publics et politiques font que les lois du marché déterminent les caractéristiques de la commande. La scène française se rapproche ainsi de la situation internationale, sur laquelle s'éteint le souffle de l'utopie réaliste qui avait concrétisé le pire, mais aussi le meilleur du logement social.
Références bibliographiques :
Bresler Henri, « Les immeubles parisiens : entre vertébrés et crustacés », in Jacques Lucan (dir.), Eau et gaz à tous les étages. Cent ans de logement social à Paris, Paris, Picard/L'Arsenal, 1992, p. 222-241.
Lucan Jacques, Architecture en France (1940-2000). Histoire et théories, Paris, Le Moniteur, 2001.
Moley Christian, L'Architecture du logement. Culture et logiques d'une norme héritée, Paris, Anthropos, 1998.
Présentation du Dictionnaire de l'habitat et du logement
Si vous souhaitez acquérir le livre
Le Dictionnaire de l'habitat et du logement est disponible à la Librairie Le Genre urbain et sur Amazon