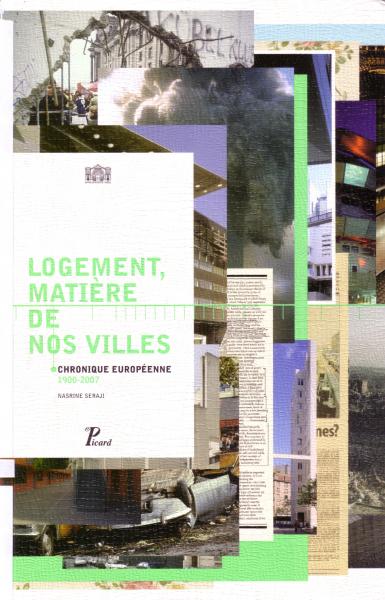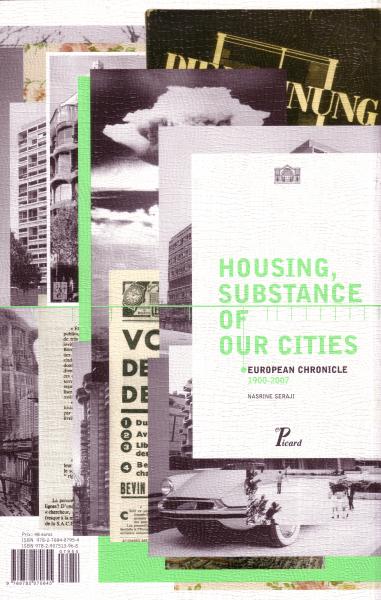« La "bande active", une utopie de Lion et Leclercq au siècle de la lumière », in Nasrine Seraji (dir.), Logement, matière de nos villes. Chronique européenne, 1900-2007 / Housing, Substance of our Cities. European Chronicle, 1900-2007, Paris, Picard/L’Arsenal, 2007, ouvr. bil. fr.-angl., p. 316-321.
Texte intégral de l'article
Dans une Histoire de l’architecture du logement encore inachevée, la “ bande active ” serait probablement à situer dans la continuité des ruptures, œuvres d’architectes et d’ingénieurs tout au long du XXe siècle. La bande active comme projet théorique (Domus demain, 1987) mérite d’autant plus d’être mise en perspective qu’elle a été appliquée dans un programme de logements sociaux à Villejuif (Val-de-Marne) et que celle-ci a été suivie d’une évaluation socio-architecturale, ce qui permet une autre compréhension de ses enjeux sur les modes d’habiter. Après deux ou trois répliques de la part d’architectes répondant à des concours d’idées, c’est maintenant du côté du Soleil Levant que la relève voit le jour, sous forme d’une réinterprétation à grande échelle par Riken Yamamoto.
Le mode de vie + l’industrie
France, années quatre-vingt. Hypnotisés par la grande commande publique mitterrandienne et par l’apparition des “ projets urbains ”, ballonnés par l'indigestion d'architectures du logement des années précédentes, les architectes se détournent des modes d'habiter. Du côté du marketing et de la sociologie des modes de vie, les palpeurs de tendance notent pourtant chez certains groupes sociaux une nouvelle considération pour le corps à travers l'essor des pratiques sportives ou de la consommation d'équipements tels que les jacuzzis. Domus demain est pensé dans ce contexte, qui est celui de Domus 2005 (1986) , du PAN 14 (1987) et du premier concours Europan (1988), lesquels proposent plusieurs variations sur l’interface chambre/salle de bains. Dans les appartements bourgeois de la fin du XIXe siècle, la petite pièce pour la toilette, attenante aux chambres, se distinguait de la salle de bains, reléguée du côté des services. Que le cabinet de toilette fût privé et destiné à tous les soins de beauté et de préparation du corps est une ambition qui sera reprise dans les années quatre-vingt par tous ceux qui souhaitent que le corps à laver, raser, épiler, coiffer, muscler trouve un lieu approprié et, de préférence, exposé à la lumière naturelle.
La même préoccupation se retrouve donc chez Yves Lion et François Leclercq, dont les résultats d’un projet de recherche soutenu par le Plan Construction inversent l'opposition conventionnelle entre centre et périphérie du logement : si la salle de bains est placée en façade, autant en compter une par chambre ; si chaque chambre a sa cabine de bains, plus besoin de couloir pour conduire à la salle de bains commune et davantage de liberté pour la partition du plan. Plus besoin de VMC non plus. Et puisque les cabines de bains sont multipliées et que les cuisines sont étirées sur la façade, pourquoi ne pas industrialiser la fabrication des unes et des autres ? C’est ainsi que le concept de “ bande active ” est posé, au confluent des réflexions sur les manières d’habiter et les manières de construire, car l’opposition entre un gros œuvre, grossier et pérenne, et un second œuvre conçu comme de l’appareillage de précision rendrait possible la fabrication en usine des cuisines, salles de bains et WC, et faciliterait leur interchangeabilité ultérieure. Les années soixante et soixante-dix avaient déjà planté le décor d’une utopie machiniste capable néanmoins de produire aussi des résultats : si les délires d’Archigram relèvent davantage de la littérature de SF que de l’architecture, les salles de bains de Charlotte Perriand aux Arcs (1967-1981), le Tetrodon de l'AUA à Oléron (1970-1972), la tour Nagakin de Kurokawa à Tokyo (1972), etc., sont les références tangibles de la bande active.
Villejuif, terrain d'application et d'évaluation
L'opportunité d'appliquer la bande active apparaît dès 1986, lors d’un concours lancé par la Semasep, aménageur de la Zac des Hautes-Bruyères à Villejuif. Le terrain proposé à Yves Lion est le meilleur, face au parc, le long d’un canal creusé par Alexandre Chemetoff. Lion charge la barque en voulant construire aussi l’inconstructible immeuble-villas, qu’il ramène à lui et à Terragni en effectuant un détour supplémentaire par la Casa Rustici (Milan, 1933-35). Trois défis en une opération de logement social ne font pas peur à l’entreprise Sicra, qui s’y retrouve par la répétitivité des plots et la simplicité des terrasses de devant (entre l’escalier ouvert et les logements), dont la superposition simplifie l’étanchéité. Un quatrième défi est même introduit par le programme, avec une diversité qui oblige à des typologies complexes dignes de l’AUA et de Bernard Paurd réunis ; la bande active est cependant appliquée à tous les logements grâce à une trame de 7,20 m d’entraxe.
La principale différence entre Domus demain et l’application de Villejuif ne repose pas sur la distribution des cellules mais sur la mise en œuvre traditionnelle des cuisines et des salles de bains, Sicra n'ayant pas trouvé de sous-traitant capable d'industrialiser quelque deux cents cabines de bains pour un prix inférieur ou égal aux salles de bains traditionnelles. Yves Lion pouvait-il vraiment croire à ce qui, hors l'habitat de loisirs et l'hôtellerie, demeure infailliblement un mythe ? Il a suffisamment fréquenté Prouvé pour en tirer la leçon de l'impossible industrialisation du bâtiment, mais il a succombé à son tour à la tentation de l’aventure.
L'enquête conduite sur presque la moitié des logements a révélé les contraintes et les bénéfices de la bande active, dont la régulation dépend principalement de la composition du groupe domestique. Les règles de pudeur dans le couple ou la fratrie utilisant une seule cabine de bains ouverte sur la chambre ne trouvent pas leur compte dans le corps à corps obligé, au contraire de l’usager seul (parent ou enfant) qui voit s’élargir son espace et son temps de confort. Reste le franchissement du domaine intime de la chambre-bains par tous les visiteurs demandant l’usage d’un lavabo, puisque la salle de bains commune n’existe pas. C’est par défaut que l'ouverture retombe sur la chambre parentale, malgré sa réputation de pièce la plus intime du logement. En revanche, les présupposés défavorables à l’éclairage de la chambre par la salle de bains ou à la confrontation du sec et de l’humide se révèlent erronés : les chambres-bains sont lumineuses et sèches… pour peu qu’on les ventile !
L’évolution que Lion fait subir à la bande active dans un projet réalisé peu de temps après, à Marne-la-Vallée (1987-1995), en maintient le principe pour la cuisine et pour la troisième chambre des quatre pièces, mais répond à la contrainte du face à face par un habile partage de la salle de bains (en façade) par deux chambres, ce que permet la trame de 7,20 m, tandis que la simple pose d’un lave-mains dans les WC résout l’entrave à l’intimité des chambres-bains de Villejuif. La proposition de Marne-la-Vallée, plébiscitée par ses habitants (malgré la chambre-bains des quatre pièces, jugée trop étroite) apparaît comme un compromis d’autant plus “ centriste ” que, par rapport à Domus demain, la gaine de la salle de bains et du WC–lave-mains revient vers l’intérieur du logement.
De beaux lendemains ?
La médiatisation rapide de Domus demain peut expliquer la parution de plusieurs projets avec bande active, mais c’est le Japon qui reprend ce qui, en partie, lui appartenait, avec des logements dotés d’une vraie bande active, construits par R. Yamamoto dans deux de ses projets. Intéressé lui aussi par l’évolution des modes d’habiter , Yamamoto a mis au point un type appelé SOHO (small office, home office) à destination des salariés célibataires dont le logement peut aussi servir de bureau. Testé dans une partie du vaste programme (2100 appartements locatifs) de Canal Court Shinonome, à Tôkyô, ce type l’a aussi été dans une tour de studios à Nigata, un autre type de logements pour couple étant lui aussi conçu avec une bande active légèrement différente à Canal Court Shinonome. L’écart avec la réalisation de Villejuif ne se résume pas seulement à une opposition sommaire “ logements sociaux en banlieue parisienne/logements privés à Tôkyô ”. Le commanditaire japonais a certes les moyens d’aménager des séparatifs entre chambre et lavabo, et entre lavabo et douche, mais la différence réside dans la position de la baignoire et des WC, en retrait derrière une petite loggia, ce qui donne davantage d’intimité à la baignoire et place en même temps les WC en façade – ce que Lion et Leclercq souhaitaient d’ailleurs dans Domus demain.
Entre temps, Lion n’est revenu à la bande active qu’à l’occasion de la candidature de Paris aux JO 2008, à propos de laquelle il fit une proposition de village olympique, à la Plaine Saint-Denis, à reconvertir en logements collectifs. On connaît la suite.
Aujourd’hui, faut-il jeter l’eau du bébé avec celle de la chambre-bains ?
Le recul sur les expériences de Villejuif et Champs-sur-Marne, et les propositions de R. Yamamoto ouvrent la perspective d’une évolution de l’interface chambre/salle de bains mais ferme celle de son industrialisation. Si, en effet, celle-ci n’a pas été possible au Japon pour des centaines de logements privés, il est sans doute inutile de persévérer dans une solution radicale, certes plus séduisante parce que formant un paradigme des mondes de l’architecture, de l’industrie et de l’usage, mais foncièrement utopique. On ne pourra plus alors parler de “ bande active technologique ”, ce qui n’invalide pourtant pas la notion de “ bande active fonctionnelle ”, en admettant que, aujourd’hui, le fonctionnalisme peut retrouver le sens de la juste relation entre forme et usage qui était celle de ses pères fondateurs . Les réponses architecturales à cette interface demeurent ouvertes si l’on pousse la réflexion vers l’aménagement de seuils horizontaux ou verticaux, vers la recherche de nouveaux matériaux translucides et acoustiquement performants, etc. Dans tous les cas, le bénéfice de l’éclairement en lumière directe et de la ventilation naturelle (par fenêtres ouvrantes) de la salle de bains et de la cuisine, est un acquis sûr. Mais il n’est pas moins sûr que la recherche de la compacité, si elle est à l’origine de solutions et de dispositifs intelligents de seuils, de filtres et d’appareils réalisés par l’industrie, est réservée à un secteur de milieu et de haute gamme. Une telle restriction suffirait-elle à condamner, en France, toute reprise de la bande active ? Oui, si l’on s’en tient au système de production des années soixante-dix–quatre-vingt qui a fait du logement social le laboratoire captif de l’innovation. Non, si, comme aux Pays-Bas, les innovations sont portées par des maîtres d’ouvrage privés s’adressant à une upper middle class séduite par une architecture design à la conquête d’un autres programme que celui des hôtels**** dont les éditeurs d’architecture internationale font leurs têtes de gondole.
Si vous souhaitez acquérir le livre
Logement, matière de nos villes/Housing, Substance of our cities est disponible à la Librairie Le Genre urbain ou bien sur Amazon