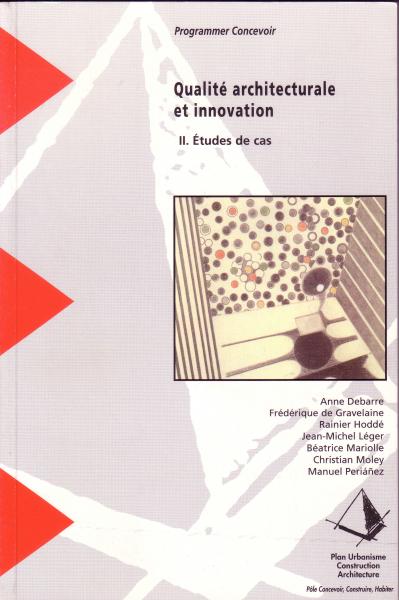« Architectures singulières, qualités plurielles (Lipa et Serge Goldstein, Yves Lion, Bernard Paurd » (avec R. Hoddé), in A. Debarre et al., Qualité et innovation architecturale, t. II, Paris, PUCA, 1999 , p. 99-119.
Texte intégral de l'article
Critiquer les notions d'innovation et de qualité architecturales offre l'occasion de croiser nos travaux sur le processus de conception et les usages du logement à l'aune de questions telles que : « Comment des architectes parviennent-ils à proposer des logements que l’on aurait envie d’habiter, condensant un grand nombre d’intentions, montrant un inhabituel souci d’usage ? », etc. Cette étude se fonde sur nos propres travaux, anciens et récents, consacrés à Lipa et Serge Goldstein et à Yves Lion , auxquels nous avons associé l'activité de Bernard Paurd, afin de mieux définir la démarche de quatre concepteurs appartenant à une génération héritière de la culture moderne du logement, dont chacun assure, à sa manière, le renouvellement. Néanmoins, ce travail n'est pas seulement autoréférencé ; nous empruntons à Michel Conan plusieurs notions comme celle du « thème architectural », qui permet de penser la constitution d’une œuvre à la fois dans sa singularité créatrice et dans sa répétitivité formelle, ou celle de la « dimension sociale de la conception », qu'il partage avec Howard Becker. De leur côté, les travaux d'Henri Raymond, auxquels répondent ceux de Michael Baxandall en sociologie de l'art, et les conférences de la Société française des architectes nous aident à penser la réception de l’œuvre et la légitimité de la critique.
L'INNOVATION : POLYSEMIE ET PRATIQUES
Importation-imposition d’une notion
Issue du monde industriel au service de la croissance, l'innovation n’est initialement que le moyen de produire de nouveaux biens ou de produire à moindre coût les mêmes biens . Puis elle devient une manière pour l’entreprise de valoriser ses technologies (nées de la recherche-développement) en élaborant des réponses aux questions posées par ses clients. La nuance est appréciable, puisque les problèmes sont formulés non plus par l’industriel, mais par son client. Ce modèle lui-même semble aujourd’hui menacé par un modèle émergent qui postule un projet non énoncé au préalable, donc une innovation impossible à engager a priori ; le problème à régler (par l’innovation éventuelle) est concomitant de la formulation de sa solution. Les travaux récents sur l’innovation montrent par ailleurs que celle-ci n’est jamais seulement technologique, mais qu'elle mobilise toujours du social pour faire son chemin et s'accomplir dans notre quotidien – ainsi le Post-it et sa colle non collante conçus chez 3M auraient pu en rester là si les inventeurs de ce petit papillon ne s'en étaient faits aussi les promoteurs en le rendant indispensable.
L’innovation se conjugue donc avec « diffusion », faute de quoi elle s’associe avec « disparition ».
Rien ne semble, cependant, unitaire dans les modélisations de l’innovation technologique évoquée, et de notables différences surviennent dans la production du logement. La principale concerne l’intégration dans l'industrie de la recherche et du développement, alors qu’en architecture concepteurs et constructeurs sont séparés et ne partagent ni les mêmes valeurs ni les mêmes logiques. En revanche, lorsqu’ils sont très complexes, les problèmes formulés en technologie semblent échapper à la démarche linéaire de quête de solution, ce qui s’accorde avec la complexité des processus de conception et d’innovation en architecture . De même, les aspects à la fois socialisés et technologiques rapprochent-ils ces deux univers et permettent-ils à une innovation imaginée d'être admise.
Dans tous les cas, c'est la technologie, elle-même baignant dans une idéologie de modernité et de progrès, qui permet à l’innovation de faire son entrée en architecture. Selon les modèles qui inspirent cette exportation, l'ignorance des divergences entre le monde de la production architecturale du logement et celui de l’industrie est plus ou moins grande. La thèse de l’origine technologique de l’innovation greffée sur l’architecture est reprise par Raymonde Moulin , qui lie historiquement et conjoncturellement l’apparition de la notion d’innovation à la rationalisation, à la préfabrication, à une logique industrielle et à la modernité technique ; cette « mystique de l’industrialisation » institue, entre ingénieurs et managers, des architectes modernistes qui redonnent un sens à leur spécificité de créateur grâce à l'innovation. Celle-ci, pourtant technique de nature, serait donc aussi un avatar de la création, une modalité de survie et de distinction, une façon pour les prétendants d'imposer de nouvelles règles du jeu aux dominants. Ainsi se dégage un premier point sur les enjeux sociaux, pas toujours avouables, d’une innovation présentée sous ses seuls paris techniques.
La position des quatre architectes rencontrés confirme les hypothèses de R. Moulin. Ils ne s'estiment pas porteurs d'innovations techniques, mais incluent la dimension technique dans celle, plus large, de la qualité de leurs projets. L'innovation autorisée par de nouveaux produits est tout au plus un moyen ; elle est alors transversale, et non isolable, car concevoir un projet d’architecture, c’est œuvrer dans des domaines différents, mais nécessairement en interaction. Avec le Placostil, B. Paurd donne, à Vitry-sur-Seine (fig. 3), un exemple de l'interdépendance entre un nouveau produit et des dispositions spatiales. En libérant le plan des logements de la structure rigide de la trame, le Placostil dissout paradoxalement son propre caractère innovant : en se mettant au service d'un projet, l'innovation se banalise. De même, à Villejuif (fig. 2), la « bande active » fut proposée par Y. Lion dans un projet conjuguant plusieurs intentions : technologies différenciées pour le gros et le second œuvre, individualisation des salles de bains, typologies en duplex, terrasses de double hauteur, escaliers libres et ouverts . La proposition finale donne certes à lire de l'invention typologique, qui n'était pourtant pas clairement affichée a priori, qui s'est découverte en quelque sorte au fur et à mesure de l'avancement du projet.
L'innovation n’est donc pure ni dans ses intentions, car elle croise les stratégies de reconnaissance professionnelle – comme le remarquerait R. Moulin –, ni dans sa mise en œuvre matérielle, car elle se perd dans la démarche architecturale – comme l'affirment les quatre concepteurs.
Déconstruction d’une notion
La double appartenance de l’architecture du logement au champ de la production artistique (ce qui fait date, ce qui est accueilli dans la culture architecturale, ce qui est légitimé par le cercle des professionnels reconnus) et au champ de la nécessité et de l’utilité (il faut loger et se loger) accroît la complexité d'une notion dont le passé technologique est repris dans des logiques esthétiques et domestiques.
Dès lors, l’innovation n’échappe pas à l’idéologie de la rupture qui domine l'art contemporain, de même que, dans les arts plastiques de cette période, nouveauté et rupture constituent l'un des critères déterminants de la reconnaissance, au point que le jamais-vu peut – ou a pu – fonder la valeur artistique. Or cette idéologie est invalidée par la sociologie de l’art, qui met en lumière le substrat de conventions nécessaires à la nouveauté, lesquelles deviennent ainsi relativement limitées et autonomes ; il n'y a ni table rase ni nouveauté entièrement nouvelle, et la référence à l'existant est une condition de la réception et de la compréhension des œuvres. Tel est le paradoxe : toute innovation doit s'appuyer sur un public, qui doit disposer des catégories de perception adéquates ; trop novatrice, elle est incomprise ou rejetée . Les avant-gardes sont peut-être en avance, mais non pas en rupture radicale puisque l’on peut reconnaître ce qu’elles produisent.
Cette relation de l'innovation à la société n'unifie pas pour autant les postures adoptées par les concepteurs ; l'innovation apparaît alors comme un enjeu social et professionnel, la querelle de mots recouvrant la tentative de construire et d'imposer une réalité. C'est ainsi que la règle du jeu du PAN, en n'imposant ni programme, ni maître d'ouvrage, ni site, sollicitait les innovations architecturales de papier les plus diverses , comme, exemples parmi d'autres, des « noyaux technologiques » (PAN 14, 1987) ou des meubles « cloisonnants » et autres dispositifs à la fois domestiques et structurels (Europan 1989) . Ainsi, pour Y. Lion, s'il y a innovation dans la reconversion d'immeubles de bureaux en logements dans les XVe et XVIe arrondissements de Paris, celle-ci est d'abord programmatique : elle relève d'une stratégie urbaine réintroduisant des logements dans des quartiers de la capitale qui en perdaient au profit de bureaux – cela évoque le temps, plus radical (1981), où Paul Chemetov déclarait qu'innover, c'était construire, enfin .
En tout état de cause, l'innovation en architecture ne peut se réduire ni à une performance technologique, ni à un radicalisme esthétique déconnecté, ni à une revendication politique ; elle se dilue, en outre, dans la globalité et la complexité du projet. Cela suscite deux questions. Comment expliquer la fortune critique et l'efficience sociale de cette notion dans le logement (auprès d'organismes d'État, d'architectes, de revues professionnelles) ? Comment définir autrement ce qui apparaît malgré tout comme une dimension effective de certains projets ? La première question supposerait une déconstruction du concept d'innovation, ce qui réclamerait l'examen tant de sa généalogie que de ses fonctions actuelles dans les discours et les valeurs qui gouvernent le champ de la production architecturale. Ainsi pourrait-on fonder une compréhension de l'innovation dans son histoire et dans son efficacité discursive. La seconde question implique un lourd travail d'évaluation de ce qui est innovant, déclaré tel initialement ou non. Néanmoins, ce faisant, on se garderait de transposer et de projeter involontairement une logique étrangère aux métiers de la conception, voire de contraindre à une lecture de l'innovation que certaines pratiques (pourtant innovantes) n'effectuent pas en tant que telles. Ancrer l'innovation dans son histoire et dans sa rhétorique, c'est la discuter avant de l'accepter ou de la réfuter.
Ainsi, entre le non-questionnement des choses par l'évaluation et des mots par leur généalogie, s'est imposée et diffusée l'idée d'innovation dans la sphère architecturale. Puisque reconnaître cette notion, c'est la méconnaître, nous tenterons de l'interroger prudemment en avançant deux hypothèses issues des travaux évoqués en sociologie de l'art et des recherches sur les processus de conception. D'une part, l’innovation fonctionne dans le champ architectural comme dans d’autres secteurs de nos sociétés ; à ce titre, elle peut s'appréhender dialectiquement avec ce qui est de l’ordre de la convention. D’autre part, l’analyse de la formation de l’œuvre du côté des concepteurs, qui est notre point de vue initial, montre que l’innovation est prise dans l’approfondissement, ce qui en relativise la nouveauté toujours renouvelée à laquelle, trop souvent, l'on croit.
Convention sociale et routine professionnelle
Si certains architectes inventent des dispositifs spatiaux extravagants, introduisent des révolutions techniques ou proposent une esthétique leur permettant de figurer au rang de créateurs, leurs innovations ne seront pas pour autant, sur le plan social, reprises et diffusées. L’innovation en architecture n’est pas réductible à un acte solitaire destiné à frapper l’imaginaire collectif. L’histoire du logement illustre bien ces innovations laissées lettre morte, alors qu'elles pouvaient sembler pleines d’avenir au moment où elles émergeaient . La période contemporaine confronte aux mêmes réalités, et – personne ne le souligne assez –, dans le passage d’un concours d’idées tel que l’Europan aux réalisations lui succédant, les innovations s’écrêtent au point que les projets mutent dans l'épreuve du passage au réel. Néanmoins, il faut considérer comme une production spécifique les dessins-manifestes, qui ont toujours constitué pour les architectes une liberté quelque peu provocatrice de présenter de nouvelles formes d'habitat et d'espace urbain. Les « châteaux » en banlieue (ensembles compacts superposant plusieurs programmes) esquissés par L. et S. Goldstein appartiennent à ce genre d'exercice jusqu'à ce qu'un jour, retravaillés et nécessairement rabotés, ils franchissent peut-être le miroir du réel. En 1987, les premières ébauches de la bande active publiées par Yves Lion et François Leclercq étaient encore en deçà du miroir quand elles représentaient une belle machine dans laquelle des éléments de second œuvre, sophistiqués et usinés, seraient venus s’agrafer sur un gros œuvre fruste et coulé en site. Entre-temps, à Villejuif, le passage à la production a balayé l'hypothèse technologique, dont, outre l'emploi de matériaux légers dans les cuisines et les salles de bains, il reste cependant l'origine typologique : une petite salle d'eau ou salle de bains par chambre, placée en façade (fig. 2). La VMC subsiste, la DDE estimant qu’un bain en façade serait insuffisamment ventilée. Dans cette opération, ultime REX du programme Conception et usage de l’habitat du Plan Construction, une part de ce qui était innovant est effacée faute de relais sociaux et technologiques efficaces, le coût des salles de bains-capsules étant supérieur à celui de la faïence usuelle – on verra plus bas la réception de ces innovations techniques et typologiques par les habitants. Et lorsque, juste après l'expérience de Villejuif, Y. Lion propose une autre application de la bande active à Champs-sur-Marne, le maître d'ouvrage en refuse la radicalité. C'est pourtant en croisant ce premier projet à des typologies plus conventionnelles que l'agence y développe des dispositifs à la fois moins radicaux que la bande active et plus ouverts que le plan standard. L'innovation est ici un point de départ du projet, mais, précisément, elle n'est que le point à partir duquel le projet se déploie et non l'objectif qu'il doit restituer.
S'inscrivant donc dans son siècle et dans un champ social qui n’accepte pas n’importe quoi, l’innovation n’existe que socialement reconnue, appropriée, développée, relayée ; dépassant le stade d’une expérience sans lendemain, elle doit porter les conditions de sa réception et de sa généralisation. Toutes sortes de relais et de groupes d’influence participent alors à cette diffusion, qui réussit d’autant mieux que la nouveauté n’est pas radicale et que sa reconnaissance rappelle ce que l’on connaît déjà. S’appuyant sur le modèle théorique de Howard Becker , Florent Champy insiste sur le rôle des « conventions partagées par les acteurs [qui] offrent l’arrière-plan de stabilité qui permet au changement d’intervenir ».
Bernard Huet a désigné le premier l’importance « de la convention et du lieu commun », dès lors que l'on parle de typologie du logement (l’articulation entre le spatial et le social) ou de morphologie de la ville (les régularités urbaines). Non seulement l’innovation ne peut se considérer en dehors des conventions – constructives, typologiques, réglementaires –, voire des procédures, mais, trop radicale, elle devient alors un obstacle à l'élaboration et à la réception du projet. L’autonomie du concepteur se trouve ainsi singulièrement restreinte sitôt qu’elle menace la convention des typologies socialement établies, ce qui n'interdit pas la recherche d'une autonomie formelle dans l'écriture architecturale. C'est ainsi que, si certains logements des frères Goldstein, d’Y. Lion ou de B. Paurd surprennent, ils peuvent être appréhendés par tout un chacun et n’offrent pas la nouveauté dont étaient dotées les expérimentations constructivistes russes ou les architectures de papier d’Archigram. Introduire le flexible dans le déterminé sous forme d'éléments mobiles (ce qu'aimerait proposer Paurd dans des cuisines tantôt ouvertes, tantôt fermées) ou de transparences occultables (ce que présentait Lion dans les dessins prototypes de la bande active) apparaît même comme une façon de faire évoluer le conventionnel sans le révolutionner.
Ainsi repositionnée dans son contexte et son sens social global, l’innovation n’est plus un isolat sur lequel se concentrent tous les regards, mais une composante fortement liée à la production, donc à ses héritages culturels et techniques, que la notion de convention met en lumière. En démontrant, à propos de l'immeuble épais et de la partition jour/nuit, notamment, comment les architectes sont les premiers agents d'une norme culturelle pétrie aussi bien des représentations de l'usage que des certitudes socio-économiques, Christian Moley retourne ce que l'on attribuait généralement à l'appareil normatif de l'Etat et à l'économie. Mais il remarque aussi que des plans apparemment atypiques, tel le plan à séjour central traversant, sont à la fois marginaux et récurrents depuis cinquante ans, c'est-à-dire qu'ils resurgissent régulièrement sans jamais pouvoir s'imposer dans la convention . Dans ce cas, de tels plans sont-ils encore novateurs ?
Construire l’innovation – qu’il faudrait peut-être nommer autrement, comme relative à l’état de compréhension et d’acceptation d’une société –, ce n’est pas en nier l'existence, c’est la relativiser sensiblement et engager une redéfinition de la marge d’invention et d’autonomie des concepteurs. C'est ce point que l'on explorera à partir des théories de conception déjà évoquées.
La nouveauté de l’œuvre touche d’abord à la définition de l’écriture architecturale et à son évolution, dans un champ culturel où les exigences de distinction et d’identification sont fortes, selon un processus de Kunstwollen . L'exhibitionnisme architectural dont tout le monde se plaint ne qualifie cependant qu'une petite minorité des architectes, les autres cherchant davantage à se positionner par rapport aux divers courants de la modernité. Voilà vingt ans que tous prétendent « s'inscrire dans un contexte », ce qui laisse ouvertes les définitions de l'inscription et du contexte ; par exemple, Y. Lion et les frères Goldstein ont chacun leur manière d'« inscrire » leurs projets dans les contextes urbains, le premier voulant être assimilable, les seconds remarquables. Toutefois, soit parce qu’ils sont reconnus, soit parce qu’il est de bon ton de ne pas l'admettre, les quatre architectes rencontrés ne s'attardent pas plus sur cette dimension visible que sur l'aspect technologique de l’innovation. Ils évoquent, en revanche, de nouveaux dispositifs en apparence difficiles à organiser : refus du « mille-feuilles » (répétition de la hauteur conventionnelle de 2,50 mètres sous plafond), différenciation intérieure et extérieure entre rez-de-chaussée, étages intermédiaires et dernier niveau, traitement du toit comme une cinquième façade (L. et S. Goldstein) ; trame large, façade assumant une fonction d'échange et pas seulement de représentation, prolongements extérieurs articulant les pièces du logement ainsi que son contact avec l'espace public (Y. Lion) ; coursives-jardins, triplex, plan libéré de la trame (B. Paurd). Tout cela participe d'une dynamique de la modernité qui n’est pas sans en rappeler les pionniers, tels Frank Lloyd Wright faisant échapper l’architecture à l’emprise de la boîte close au profit de l’espace ouvert et unitaire ou Alvar Aalto poursuivant en élévation le travail de libération de l’espace.
Derrière ces dispositifs complets et complexes se profilent des « thèmes architecturaux » spécifiques à chaque architecte. Issue de travaux théoriques sur la conception architecturale, la notion de thème architectural articule des problèmes matériels et des attentes plus symboliques ; elle introduit également une relation consubstantielle avec la répétition au regard de l’ensemble de l’œuvre d’un architecte, l’innovation n’étant plus la nouveauté perpétuellement renouvelée, mais plutôt la déclinaison itérative de thèmes. Faire œuvre d’architecte, c’est donner des réponses architecturales à la fois pratiques et inscrites dans la culture, et c’est parfois élaborer des thèmes architecturaux plus personnels, les reprendre et les développer dans des projets ultérieurs, en se donnant l’occasion de revenir sur son propre travail. Opérationnel chez Wright (le thème du foyer central ), Aalto (l'extérieur à l'intérieur ), Koolhaas (l'arrachement à la gravitation), Nouvel (le grand logement) ou chez d'autres contemporains convaincus de la dimension culturelle de leur pratique , le thème architectural se retrouve aussi chez nos quatre architectes, même s'il ne s'impose pas d'évidence. Bien que Y. Lion éprouve chaque fois le sentiment de partir de zéro, la façade apparaît dans chacun de ses projets comme le lieu de la confrontation entre l'architecture et l'usage. L. et S. Goldstein revendiquent le thème de la coupe sur l'immeuble (que l'on pourrait nommer la « coupe libre »). Quant à B. Paurd, les typologies complexes sont un des objets de son enseignement, avant d'être appliquées dans chacune de ses réalisations ; en réhabilitation, c'est la structuration symbolique de l'habiter de ces lieux sans repères qu'il tente de consolider, l'architecture étant un moyen de leur redonner du sens. Quelquefois, l’interruption d'un processus exploratoire d’un thème architectural peut provenir des acteurs, et non des concepteurs. La rectification du dernier immeuble de L. et S. Goldstein pour L'Effort Rémois – celui-ci leur ayant réclamé dorénavant plus de discrétion après le flamboyant « Goldorak » – montre que rien n'est jamais acquis dans l'ouverture à l'innovation, si bien que naissent de nouveaux thèmes architecturaux qui se substituent à ceux dont l'exploration se clôt. Cet aspect du travail de l’architecte, itératif mais inventif, conjoncturel car appliqué, est beaucoup plus important qu’une taxinomie des diverses innovations, parce qu'il permet de reconsidérer sa pratique effective et son processus sans les réduire à des catégories a priori, en percevant l’inertie paradoxale de sa dynamique.
D’une certaine façon, deux indices confirment que les architectes choisis s’inscrivent, par leur pratique, dans cette mise en question de l’innovation architecturale. Un premier indice réside dans leur réserve à l'égard de ce thème imposé : ils ne revendiquent pas l’innovation, ne recherchent pas le nouveau à chaque réalisation, mais semblent au contraire approfondir avec une certaine constance une démarche singulière. Chez L. et S. Goldstein, on passe – c'est là un second indice – du « coup » architectural à la vigilance des coûts sur le long terme, le temps venant s'incorporer à l'œuvre. Réapparaît ici l'idée que l'innovation s'absorbe dans le temps.
Dissoudre l'innovation
Le paradoxe de l’innovation – marge étroite dans la convention et répétition de thèmes évolutifs – redéfinit complètement la notion en l'orientant vers un dynamisme socialement prudent et professionnellement construit. Il conduit à rompre avec l’idéologie d'une liberté maximale et esquisse plutôt un mécanisme doublement surdéterminé : pour ceux qui en prennent l’initiative, l’innovation s'inscrit à l'intérieur des limites de leur capacité propositionnelle, et elle ne sera intelligible et acceptable que pour autant qu’elle accepte les conventions propres au champ culturel et à une formation sociale. D’une certaine manière, le choix de traquer empiriquement l’innovation chez des architectes considérés comme innovants (sans pour autant s'abstraire d'interprétations théoriques) aura été payant : au-delà de la rupture espérée avec les présupposés les plus communément admis de l’innovation, ce choix a identifié et qualifié, de façon inattendue, certains liens entre l’innovation et la société.
La valeur de l'innovation dans la production architecturale du logement se trouve ainsi à la fois renforcée et affaiblie. Renforcée, car décider d'innover devrait inciter à la constitution raisonnée de protocoles rigoureux, à la définition d'ambitions plus mesurées, à une vigilance accrue tout au long de l'opération et enfin à une évaluation sans faille et sans fard. N'étant plus un « coup » isolé, l'innovation participe à l'interrogation des critères mêmes d’appréciation et de critique du logement : elle doit localiser l'inédit dans le conventionnel, le répétitif dans le personnel, et, pour cela, la critique doit forger d'autres concepts, parler un langage neuf qui rendra inappropriée l'approche précédente. Ce ne serait pas l'un des moindres effets de certaines innovations que de parvenir à infléchir les méthodes de la critique.
Mais, en même temps, l'innovation se trouve définitivement affaiblie, puisqu'elle n'est plus le terme dialectique qui accompagne automatiquement la qualité, et n'est qu'un critère possible contribuant éventuellement à une opération de qualité. En ne faisant plus couple exclusif avec la qualité, l'innovation perd sa position hégémonique dans la définition de la qualité.
LA QUALITE : COMPETENCE ET PERFORMANCE
La qualité, ainsi éloignée du « bruit » de l'innovation, n'est pas pour autant identifiée. Utilisé comme un viatique par certains (tels les critiques, le Plan Construction), le terme de qualité fait partie du vocabulaire des maîtres d'ouvrage mais non de celui des architectes ni de celui des habitants. La notion de qualité est néanmoins présente auprès de chacun d'eux ; on établira donc, dans un premier temps, les équivalences de ses définitions selon les acteurs.
Les architectes : l'écriture, le contexte, les acteurs
C'est d'abord en référence à une façon de voir le projet des architectes, leurs exigences dans la conception et le chantier, que l'on peut repérer leur pratique et leur représentation de la qualité, habitants et critiques venant vérifier ou contredire la pertinence de leurs choix. Pourtant, la reconnaissance s'effectue selon une logique inverse, puisque, on ne le sait que trop, l'architecture d'auteur demeure le modèle dominant depuis deux décennies. Le contre-modèle de « soumission de l'architecture à la ville », soutenu depuis toujours par Bernard Huet, gagne en influence – pour des raisons électoralistes ? – dans l'urbanisme d'une ville comme Paris, ce qui ravive en retour chez certains architectes la revendication de la position d'artiste créant des objets singuliers. Y. Lion figure, à notre avis, parmi ces concepteurs dont les engagements sont décalés du langage architectural, comme si leur écriture restait attachée à une modernité dominante, alors que leur réflexion sur la ville et sur la présence de leurs propres bâtiments dans la ville rejoint celle de B. Huet. On le voit à la fois séduit et inquiété par les propositions minimalistes, quand un Roger Diener maximalise des images de quotidienneté et de banalité. La retenue dans l'écriture d'Y. Lion ne suggère-t-elle pas un « silence éloquent »? En fait, à l'instar de celle de R. Diener, son architecture en dit plus qu'elle n'en montre : il faut beaucoup d'efforts pour arriver à si peu, comme il le déclare lui-même du plus chic de ses confrères bâlois. Ses intentions explicites s'inscrivent en tout cas dans la tradition de la culture du logement moderne, jusqu'à ce qu'il estime devoir la dépasser pour donner davantage à l'usage. En contestant la prétendue rentabilité de l'immeuble épais, il allonge la trame et le linéaire de façade pour mieux éclairer l'intérieur (y compris la salle de bains). Il conçoit les façades depuis l'intérieur, à partir de leur usage fonctionnel, en y intégrant au moins une tablette, au plus la bande active des équipements du logement. Ses prolongements extérieurs sont destinés à être véritablement utilisés ; suivant la leçon de Terragni dans la Casa Rustici, à Milan, ils assurent également la liaison entre la domesticité et l'urbanité de ses bâtiments.
A la ligne claire d'un Y. Lion tendant au classicisme s'oppose la luxuriance de L. et S. Goldstein, dont les bâtiments comptent parmi les plus immédiatement identifiables de la production française. Plus nettement que les autres, les frères Goldstein affirment vouloir inspirer une émotion esthétique par une volumétrie, un jeu sur les formes et la lumière, un choix de matériaux, selon un registre rompant avec la modernité lisse – au point que leur maître d'ouvrage rémois favori, comme on l'a vu, leur suggéra d'être désormais plus discrets dans le paysage urbain. A propos de leur première opération rémoise, qui n'est pourtant pas la plus voyante, ils déclarent que le décor était destiné à cacher le conventionnel . La convention était encore présente à l'intérieur dans la première tranche ; elle l'était déjà moins dans la seconde, où ils commencèrent à travailler sur les différences de niveaux de l'immeuble et de l'appartement, thème qui traverse leur œuvre jusqu'à aujourd'hui. Leurs bâtiments et leurs logements soulignent toujours la différence entre un bas (par un soubassement, un glacis, l'aménagement des rez-de-jardin), un milieu et un haut (par des rampants sous toiture), mais aussi entre le séjour, la cuisine et les chambres . Passé le jeu appliqué au décor de leurs premières œuvres, leur rhétorique architecturale se joue dorénavant de l'inévitable massivité et répétitivité du logement collectif par un brouillage subtil de la lecture des bâtiments. Ainsi, à Arcueil, la façade récite de longues horizontales indépendantes des planchers qui suivent la pente du terrain, mais les décalages de niveaux s'effectuent à l'intérieur des appartements et non sur le mitoyen, ce qui est une manière de renouveler l'un des thèmes architecturaux propres aux architectes.
Alors que les frères Goldstein s'attachent aux dilatations de volumes et aux différences de niveaux dans l'appartement, B. Paurd poursuit la mise au point de « duplex croisés latéraux » dans ses réalisations de Reims, de La Courneuve et de Vitry-sur-Seine. Quoique conçues à l'intérieur des 2,50 mètres standard, ces « typologies complexes », héritées de l'Unité d'habitation de Marseille et développées entre-temps par l'AUA, maximisent l'autonomie et la luminosité des pièces sur plusieurs niveaux, tout en gagnant économiquement et thermiquement avec l'épaisseur de l'immeuble. La recherche d'une circulation en boucle à l'intérieur du logement veut anticiper les conflits d'usage et donner des fluidités visuelles horizontales, verticales, obliques. Si cette volonté, pas plus que celle d'offrir des prolongements extérieurs, n'est pas unique, la superposition de jardinets est une réinterprétation de l'immeuble-villas mythique, l'ensemble des propositions appliquées à Vitry ayant été salué comme « un événement dans la production française de logements ».
Ces quatre architectes appartiennent bien à la même culture du logement et se rencontrent sur des axes essentiels affirmant le confort et la dignité du logement social : le dialogue avec la ville, la surface (du moins le sentiment de la surface), la lumière, les prolongements extérieurs, les différences de hauteurs sous plafond. Ils se séparent dans l'économie constructive de l'immeuble et dans l'écriture architecturale de la façade. B. Paurd, L. et S. Goldstein restent fidèles à l'immeuble épais, auquel ils confèrent une transparence, au prix de morceaux de bravoure (les frères Goldstein à Reims avec « Goldorak », B. Paurd à Vitry), tandis que Lion privilégie l'immeuble mince – lequel demeure malgré tout une réponse réputée coûteuse.
Le second facteur principal de réussite d'une opération selon les architectes – ce n'est pas une surprise – est la bonne coopération avec le maître d'ouvrage et les entreprises. La facilité avec laquelle le milieu professionnel est prêt à dégainer contre un confrère justifie le terme de milieu, logiquement divisé en clans. Si, entre fausse gémellité et vraie complémentarité, la fraternité caractérise véritablement l'activité des frères Goldstein, c'est le mot confrère qu'Y. Lion charge de sens quand il qualifie ses relations avec ses associés et les salariés de l'agence, bien sûr, mais aussi avec ses anciens associés et ses confrères appelés dans les mêmes ZAC, tous ces échanges produisant une sorte d'énonciation collective des projets.
Avec le maître d'ouvrage également, voire avec les élus, la complicité est souhaitée. Y. Lion a fait évoluer l'orthodoxie de la bande active à Champs-sur-Marne dans un dialogue direct avec Paul Marty, directeur de l'OPAC du Val-de-Marne. Aujourd'hui, il constate que cet OPAC s'est « dépersonnalisé », mais il a trouvé un autre partenaire de caractère en la personne d'un promoteur en accession populaire avec lequel il aura réalisé trois opérations . La palme de la longévité revient à L. et S. Goldstein, qui ont conçu avec L'Effort Rémois quatre opérations en une douzaine d'années , soit le temps nécessaire à la gestation et à l'accouchement d'un îlot à Arcueil, l'une de leurs dernières livraisons. B. Paurd raconte, quant à lui, comment, à Vitry, le maître d'ouvrage Edgar Cohen-Skalli fut co-initiateur d'un des dispositifs du projet (les larges coursives-jardins). A des commandes parachutées il dit préférer le suivi de ses interventions à La Courneuve (de la caserne des pompiers à la réhabilitation de deux barres des « 4000 », en passant par un aménagement urbain).
Les relations avec les entreprises sont conformes à ce que l'on sait. Les architectes ont tous souligné l'intérêt des entreprises pour les chantiers difficiles, mais qui rompent avec la routine et mettent à l'épreuve la compétence proprement technicienne de celles-ci. Le partenaire le plus approprié à ce type de chantiers est la PME, avec laquelle on peut intervenir sur le chantier, qui est encore, on le sait, l'ultime mais nécessaire étape de la conception.
Les habitants : le quartier, le loyer, le confort
Chaque opération de logements constitue une situation, c'est-à-dire une expérience singulière incomparable aux autres opérations par l'unicité de sa localisation, de sa population, de son architecture (ce n'est pas parce que les barres d'un grand ensemble se ressemblent que les situations habitantes sont identiques). Les savoirs sur les usages sédimentés depuis trente ans indiquent, certes, les traits majeurs des comportements et les grandes lignes des réponses aux dispositifs innovants ; ils sont toutefois susceptibles de réinterprétations selon les contextes urbains et les occupants, mais très peu d'enquêtes interrogent ces interactions entre contexte et usage. De telles investigations permettraient de mieux anticiper les effets des projets innovants ; on peut d'ailleurs s'étonner du peu de curiosité dont font preuve maîtres d'ouvrage et architectes pour connaître la réception d'une production ayant pourtant représenté de leur part un investissement intellectuel et financier considérable . Sur cette question, les quatre architectes ne se distinguent pas de leurs confrères. Les relations d' Y. Lion avec des sociologues décrypteurs des usages ont été guidées plus par le hasard de rencontres professionnelles et personnelles que par une vraie demande de savoir sur les usages, ce qui n'exclut pas un réel intérêt de cet enseignant et animateur d'une nouvelle école d'architecture. Par exemple, lors d'une confrontation directe avec les habitants, à propos de la consultation d'urbanisme de la rue des Thermopyles (Paris-XIVe), les divergences culturelles entre architectes et habitants lui sont apparues plus fécondes et stimulantes qu'infranchissables.
Deux projets des frères Goldstein et deux autres signés Y. Lion ont été l'objet d'études , ce qui appelle quelques commentaires, sans pour autant généraliser, les dispositifs et les contextes étant à l'évidence en interaction les uns avec les autres. Les enquêtes réalisées à Reims dans les deux tranches successives de la rue Baussonnet dépassent cependant leur cas isolé quand elles confirment comment les habitants des classes moyennes emboîtent le pas innovant des architectes (espaces ouverts, angles aigus, décalages de niveaux, hauteurs sous plafond différenciées), alors que l'économie pratique et symbolique des habitants des classes populaires les oblige à une définition de l'utile plus stricte, observation largement vérifiée ailleurs. La bienveillance de L. et S. Goldstein n'échappe cependant pas à une majorité d'habitants qui, par-delà une valorisation sociale voulue par L'Effort Rémois, valident les intentions des architectes tant sur les accès et les parties communes que sur la présentation des immeubles, dont les éléments de décor (les statues en couronnement) sont considérés, à l'égal des couleurs et des matériaux, comme l'éloge d'une différence affirmée.
La conception par Y. Lion d'ateliers-logements pour artistes, selon le programme de la RIVP pour le passage de Flandre (Paris-XIXe), porte elle aussi des enseignements au-delà de cette réalisation. Les vrais artistes qui y sont logés souffrent de ne pas disposer d'un espace de travail nettement distinct de leur espace personnel, tant pour les nuisances (poussière pour les sculpteurs, odeurs pour les peintres) que pour la séparation sociale entre vie professionnelle et vie privée. Quant à Villejuif, la suppression de la salle de bains unique au profit de l'aménagement d'une salle d'eau ou d'une salle de bains par chambre y demeure une expérience unique. L'utilisation de ces chambres-bains suppose une adaptation, dont le coût est comparé avec les bénéfices des autres dispositifs et supports d'identité et avec leurs déficits, dont l'emploi, dans la cuisine, de matériaux légers mais non appropriables (il est permis de redouter ce qu'aurait introduit l'industrialisation des cuisines et des salles de bains). Dans cette comptabilité symbolique, l'inégalité des ménages (selon, notamment, la présence et l'âge des enfants) distingue ceux qui savent manier, voire détourner, le mode d'emploi de la chambre-bains et ceux qui n'en vivent que les contraintes . Mais les qualités ou les défauts des chambres-bains entrent aussi dans ce compte auprès du montant du loyer, eu égard à l'image sociale du quartier, au « bon » voisinage, à la vue sur le parc, au duplex, au grand séjour, à la vaste terrasse, chacun de ces espaces et marqueurs d'identité sociale étant très valorisés – hormis les escaliers d'accès, au traitement trop sommaire . Ainsi, il est impossible d'extraire de son contexte la pertinence de la conception de la chambre-bains, et il reste à connaître la fortune de la cellule de Champs-sur-Marne, mutante, et non pas simple clone de celle de Villejuif.
La critique : la légitimité
Les questions sur la critique sont intrinsèquement liées à celles de la légitimité de juger, et elles débouchent sur celles de la légitimité des architectes dans leur milieu. Selon Daniel Payot , le critique, en s'exprimant, a déjà répondu à sa propre légitimité ; s'il écrit, c'est qu'il est fondé à le faire. A partir de là, il a tous les pouvoirs, puisqu'il n'est pas tenu de livrer sa raison d'être. Or d'aucuns se plaisent à dire que la critique est un simple effet de miroir entre deux personnes de qualité, et même qu'il n'y a pas de critique véritable en France. Si tel est le cas, la logique voudrait que, s'il n'y a pas d'infamie à être ignoré par les revues, il n'y a pas non plus de gloire à y figurer. On conçoit bien, malgré tout, que la publication (puisque il s'agit de cela) est une façon de se mesurer à l'Audimat du milieu. L'échelle des renommées dans les médias d'architecture serait, quant à elle, affaire de critique de la critique. L'Architecture d'aujourd'hui, autoproclamée la plus prestigieuse, en tout cas la plus internationale, n'a, ces dernières années, ouvert ses colonnes ni à Y. Lion, ni à B. Paurd, ni à L. et S. Goldstein, qui sont publiés par d'autres revues françaises et étrangères. Outre les publications dans les revues d'architecture et, plus généralement, dans la presse, la légitimité des architectes se fonde sur certaines récompenses de jurys : prix, palmarès, grands concours (où le PAN fait figure d'exception libre ). Elle s'appuie également sur la tenue d'un discours sur l'architecture en tant qu'enseignant, ce qui est le cas d'Y. Lion et de B. Paurd . La stature professionnelle d'Y. Lion ne lui a cependant pas permis d'imposer la bande active à Champs-sur-Marne, comme on l'a vu, ni, comme on va le voir, de réaliser des maisons Phénix alternatives. En revanche, avoir été choisi par le maître d'ouvrage le plus parisien pour lui construire intra-muros sa maison particulière est un diplôme ès architectures de l'habitation qui vaut à lui seul bien des palmarès.
Le programme : la qualité dans l'inattendu
L'évaluation des opérations de logements n'a de sens que si elle est référée à leurs programmes et à leurs financements. Des quatre architectes, Y. Lion est le seul à travailler aussi hors du cadre habituel du logement social (PLA, PLI, PAP). D'emblée, il a posé la question de la qualité selon le programme en présentant les moins nobles (en apparence) de ses références – les programmes en accession populaire pour ARC Gestion, avec des plans simplement « carrossés » par lui. Ici, la qualité serait représentée par la géométrie apportée aux plans et à l'enveloppe architecturale de programmes d'ordinaire peu gourmands d'architecture. Y. Lion lève le paradoxe entre l'accession en banlieue populaire (pour la petite classe moyenne) et les PLA-PLI parisiens (pour cadres supérieurs, de fait). Etre engagé, serait-ce aussi accepter de travailler pour la promotion privée lorsqu'elle est populaire et épargne toute compromission ? Évidemment, l'éthiquement correct, mais pauvre, produit une architecture correcte mais pauvre elle aussi. Comment, alors, la juger sans la référer à ses 10 000 francs le mètre carré vendu , c'est-à-dire à ses 5 000 francs le mètre carré construit ? La qualité (d'architecture) peut-elle être jugée sans la quantité (d'argent) ? Lion dit qu'à Bercy il y a et l'argent et la qualité, mais qu'entre Bercy et Aubervilliers « ce n'est presque plus le même métier ». Ainsi la question de la qualité ne devrait-elle pas être tant posée à Bercy, ou à la caserne Schomberg (Paris, quai Henri-IV...), qu'à Sainte-Geneviève-des-Bois et à Aubervilliers. Mais selon quels critères, s'il ne s'agit plus du même métier ? On en vient tout naturellement au rapport qualité-prix : si l'évaluation de la qualité demeure une boîte noire, le bilan financier d'une opération est souvent, lui aussi, d'une grande opacité .
On ne pourra pas évaluer les maisons Phénix dessinées par Y. Lion il y a quelques années. Lorsque le célèbre pavillonneur fit appel à lui, ainsi qu'à P. Chemetov, pour « relooker » le produit et l'image de la marque, il s'attachait leur compétence et leur notoriété. L'expérience est restée sans lendemain, le directeur suivant ayant tourné la page ; si toutefois le marché (ou plus exactement la manière dont Phénix pense le marché) avait pu répondre, une suite y aurait probablement été donnée . Les confrontations d'un architecte du secteur public avec le privé invitent, en tout cas, à nuancer l'opposition convenue entre les deux cultures, de même que les pratiques des promoteurs privés (quand elles savent prendre en compte les usages et l'évolution de la famille) gagneraient à pénétrer le secteur public .
OBJECTIVER, C'EST SUBJECTIVER
Qualité et qualités, évaluation et évaluations
L'appel d'Y. Lion à une « réconciliation » entre architectes et habitants peut-elle être autre chose qu'une paix des braves sur le terrain d'une surenchère d'où les protagonistes sont sortis épuisés ? Sans prétendre passer outre aux logiques d'acteurs, une telle attitude veut ouvrir un dialogue entre les acteurs. Le risque est de voir les habitants instrumentalisés, comme ils le sont déjà par les institutions quand critiques et évaluateurs utilisent leurs réactions à telle ou telle réalisation innovante pour asseoir leur propre argumentation. Il suffit de se rappeler – nous sommes bien placés pour le dire – comment les évaluations des réalisations expérimentales (REX) du Plan Construction ont replacé la parole des usagers dans la double perspective des intentions de l'architecte et de la politique du programme expérimental : cette parole s'est souvent trouvée désamorcée et sa portée critique, atténuée. L'interprétation du sociologue opère donc une transformation de l'évaluation brutale effectuée par les habitants. La critique, généralement sourde et aveugle face à l'expression des usages, garde davantage encore ses distances avec le terrain et recherche dans l'histoire (des idées, de l'architecture) les moyens de situer la réalisation qu'elle décrit. Finalement, l’interprétation théorique de l’ordre pratique est un problème pour le sociologue comme pour le critique, l’émergence de l’évaluation « scientifique » étant censée répondre à cette préoccupation.
Soumises à ces exigences contradictoires, les méthodes d'évaluation alignent des listes de critères remarquables par leur arborescence infinie et leur absence de hiérarchie, ce qui affaiblit leur pertinence face à la singularité de chaque opération évaluée. Non reconnues hors des officines de leurs fabricants, les méthodes sont moins bien diffusées que les innovations ne sont étudiées. Leurs critères résultent généralement d'un compromis entre les enjeux scientifiques et professionnels des évaluateurs et ceux d'une administration représentant les intérêts des administrés, sans oublier ceux de l'industrie du bâtiment. L'épreuve de toutes les formes de jurys (de concours, de palmarès) montre que les choix se font sur des hiérarchies implicites. L'explicitation des critères pourrait donner lieu à des débats affichant plus clairement la position et les objectifs des évaluateurs et des jurys. Qui évalue quoi, au nom de qui ?
Le jugement des habitants est-il le jugement dernier ?
On se souvient comment Henri Raymond a expliqué aux architectes la « compétence » des habitants sur leur espace, c'est-à-dire leur capacité à accomplir des gestes et à leur donner du sens. S'appuyer sur l'habitus qui prédispose mais se révèle aussi apte à faire évoluer, ou insister sur l'importance du sens véhiculé par les changements dans les pratiques, fait apparaître un habitant plus ouvert et plus souple que prévu, capable de procéder à des arbitrages en fonction des situations. L'évaluation effectuée par les occupants, dont les enjeux d'usages concrets et symboliques de l'architecture sont immédiats – à la différence des évaluateurs et des critiques, ils ne sont pas étrangers à l'opération jugée –, aide à définir la nature du lien entre les critères. Il nous semble que la qualité du logement forme pour les usagers une sorte de chaîne syntagmatique, la notion linguistique de syntagme exprimant à la fois l'interdépendance et la complémentarité de chacun des termes pour la compréhension de l'ensemble de l'énoncé, et en même temps leur relative autonomie, chacun des mots ayant une signification propre. S'agissant des bâtiments de L. et S. Goldstein à La Courneuve, il paraît en effet difficile, a priori, d'attribuer un coefficient à la qualité d'un quartier qui est à la fois à l'ombre de la réputation des « 4 000 » et à la lumière d'une réhabilitation symbolique. De même a-t-il fallu attendre l'évaluation des bâtiments d'Y. Lion à Villejuif pour établir comment la chambre-bains, dispositif assurément inédit, y est mise en balance avec d'autres chaînons valorisants, sinon innovants (dimension, duplex, terrasse, vue, quartier).
Si donc il serait démagogique de laisser le dernier mot à l'habitant qui n'exprime pas l'intérêt général, une meilleure prise en compte de cette parole supposerait sans doute, comme le suggère F. Champy , de faire appel aux concepteurs les plus engagés dans la relation de service, dimension du métier d'architecte assurément à promouvoir.
Vers un engagement en architecture
Non seulement l'innovation évite de parler de qualité, mais la notion de qualité architecturale elle-même évite de parler d'architecture. Brandie plus souvent que l'innovation, la qualité apparaît comme un filtre. Elle assigne à prendre un parti global, alors que le regard critique devrait inviter à préciser, pour en débattre, les questions posées par l'espace. La critique serait alors un moyen de comprendre les pratiques constatées et les émotions éprouvées, c’est-à-dire, en fin de compte, de fertiliser le débat sur les qualités (et les défauts) des architectures. Dès lors, la critique ne peut rester académique et sans terrain. Elle doit aller vers les œuvres et ne pas refuser le conflit des idées et des partis, elle doit inventer les termes d'une nouvelle dialectique entre, d'une part, les valeurs culturelles de l'architecture (qui alimentent le débat esthétique et participent à l'émotion collective) et, d'autre part, les valeurs domestiques (liées aux usages). Mais, pour écouter les voix savantes comme les voix populaires, pour parler de la participation de l'architecture à la culture comme du détail d'usage, bref, pour parler du beau et de l’utile, la critique ne peut éviter de s'engager.
Si vous souhaitez consulter le livre
Le livre Qualité architecturale et innovation est consultable au Centre de documentation de l'Ipraus