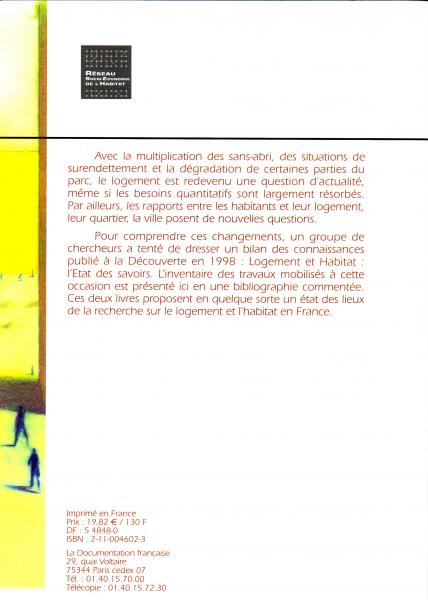« Bibliographie commentée sur : Habiter le logement, habiter la ville », in Catherine Bonvalet, Jacques Brun, Marion Segaud (dir.), Logement et habitat, bibliographie commentée, Paris, La Documentation française, 1998, p. 227-232.
Texte intégral de l'article
BERNARD Yvonne, « Ménages et modes de vie », p. 13-39 et DARD Philippe, KAUFMANN Jean-Claude, « Échanges et services », p. 41-68, in : François ASCHER (coord., 1995), Le logement en questions. L'habitat dans les années quatre-vingt-dix : continuité et ruptures, Ed. de l'Aube, coll. Monde en cours, La Tour d'Aigues.
Les deux premiers chapitres de l'ouvrage de synthèse coordonné par F. Ascher ajournent et modernisent l'approche des modes d'habiter. Y. Bernard élargit le propos de sa France au logis (Mardaga, 1988) pour placer les modes d'habiter dans le contexte démographique et dans celui des marchés du logement, en comparaison avec la situation européenne. Elle inscrit leur évolution dans celle des temps sociaux et du travail féminin, lequel influe sur la répartition des tâches et sur les pratiques, bien que la différenciation des rythmes familiaux n'implique pas, par exemple, la désynchronisation du repas familial. En rappelant les dissemblances des pratiques selon les catégories sociales, Y. Bernard insiste sur le rôle sécurisant du logement pour les populations précarisées.
La contribution de Ph. Dard et de J.-Cl. Kaufmann fait état d'un nouveau champ de recherche : le logement comme bien recomposé par la production d'échanges entre l'intérieur et l'extérieur. La place du logement n'est pas la même selon la structuration des relations ; dans le réseau exclusif des classes populaires, l'inscription identitaire dans le territoire de l'habitat est forte. Les relations de voisinage étant proportionnelles à l'importance du réseau, elles sont donc également les plus faibles chez les ouvriers, contrairement à ce que l'on croit. L'externalisation des activités familiales suit le même schéma. La délégation d'activités, plus développées dans les familles des catégories supérieures, ne vide pas la famille de son contenu : ces activités sont remplacées par d'autres pratiques familiales, leur somme étant, selon les auteurs, en croissance continue.
BOURDIEU Pierre (1979), La distinction. Critique sociale du jugement, Ed. de Minuit, coll. Le Sens commun, Paris.
Avec La Distinction, P. Bourdieu entrait dans le domaine d'un plus large public. Il y confirmait ses positions jugées « néomarxistes » en développant une analyse des classes et des classements qui apparaissait comme un rappel à l'ordre au moment où chantaient déjà les sirènes de la moyennisation. Pour l'usager moyen, l'ouvrage est un savoureux livre de cuisine de nos pratiques. Certes, celui qui est intéressé par les modes d'habiter ne trouve pas l'entrée « logement » dans un index pourtant monumental et doit chercher son chemin dans la galaxie des styles de vie. Il y parvient par recoupements, l'exposé magistral de la formation des jugements de goût permettant à chacun de préparer ses propres recettes. Il est malgré tout dommage que, pour une compréhension plus serrée du champ de l'habitat, il faille en rester au numéro d'Actes de mars 1990, dans laquelle la maison individuelle était tout de même ramenée au pire terrain clos de l'aliénation.
ELEB Monique, avec Anne DEBARRE (1995), L'Invention de l'habitation moderne. Paris 1880-1914, Hazan et Archives d'architecture moderne, Paris, Bruxelles.
Venant après Architectures de la vie privée. Maisons et mentalités XVIIe-XIXe siècles (AAM, Bruxelles, 1989), écrit par les mêmes auteurs, cet épais volume sur l'invention moderne nous touche de plus près, puisqu'il rend compte de la production et de la société d'une époque qui précède immédiatement la nôtre. Il est le seul du genre à traiter simultanément des questions sociétales et des réponses architecturales : l'attention aux enfants, l'éveil à l'hygiène, les relations hommes-femmes, le souci des domestiques, l'arrivée des inventions techniques, etc. L'organisation de l'habitation, objet de civilisation, permet d'étudier la société : les manières d'habiter sont aussi les manières de penser la société et les manières avec lesquelles la société se pense. La réflexion sur le rôle de l'architecte, sur la commande, mais aussi sur le rapport à l'histoire et à la modernité place l'habitation dans le contexte des idées, avant de restituer les manières d'habiter, au moyen des récits et des témoignages. Les quelque 500 illustrations ne sont pas là simplement pour illustrer, elles sont la matière même de cette pièce de la culture socio-architecturale.
JUAN Salvador (1991), Sociologie des genres de vie. Morphologie culturelle et dynamique des positions sociales, PUF, coll. Le Sociologue, Paris. et JUAN Salvador (1995), Les formes élémentaires de la vie quotidienne, PUF, coll. Le Sociologue, Paris.
Pour fonder l'explication compréhensive de la vie quotidienne, S. Juan a réalisé une œuvre de clarification théorique au moyen de deux ouvrages qui se complètent. Il rappelle et précise les définitions de toutes les notions souvent utilisées l'une pour l'autre (pratiques, usages, modes de vie, styles de vie). Il ranime la notion de « genre de vie », dont il fait la mesure de l'écart à la norme ; dans ce cas, les usages forment un mode de vie, le style de vie étant ce qui particularise l'individu et le genre de vie ce qui indique la variation de ces usages dans une population homogène. Dans le second ouvrage, qui traite des usages dans la vie quotidienne, on méditera le résultat d'une des enquêtes : « ce n'est pas le mode de logement qui transforme la vie quotidienne, mais ce sont des populations très différentes, de par leur origine, qui habitent des logements différents » (1995, p. 222).
BONVALET Catherine, MERLIN Pierre [eds] (1988), Transformation de la famille et habitat, Travaux et documents, Cahier n° 120, INED-DREIF-INED-PUF, Paris.
Cet ouvrage, issu d'un colloque, est, de fait, le premier « état des savoirs » sur l'habitat. Il exposait en 1988 les questions qui ont donné lieu depuis aux développements que l'on sait : l'augmentation des divorces et des familles monoparentales, la diminution de la taille des ménages concomitante de la multiplication du nombre de ménages, le paradoxe de la décohabitation des jeunes (à la fois plus précoce et plus tardive), l'accroissement du parc pavillonnaire et l'extension des mobilités, la baisse du logement locatif et la paupérisation des occupants du logement social, les difficultés des populations fragiles (immigrés, grandes familles, personnes âgées), etc. Contre les idées reçues de l'époque, l'ouvrage nuance l'isolement des ménages urbains vis-à-vis de leur parentèle et démontre le poids des solidarités familiales ; il appelle déjà, pour l'étude du logement, à dépasser l'habituelle notion de ménage pour s'élargir à la famille. Le logement y apparaît comme une « histoire de famille », qui sera le titre d'un ouvrage ultérieur coordonné par C. Bonvalet et A. Gotman (L'Harmattan, 1993).
La situation a peu évolué depuis, à l'exception d'une reprise de l'offre locative privée, traditionnellement liée à la conjoncture des avantages fiscaux, si bien que la pertinence des analyses et de l'engagement des propositions n'ont rien perdu de leur acuité. Alors que tant d'ouvrages collectifs sont de grosses commodes aux tiroirs coincés, celui-ci est unifié par la vision véritablement politique de ses auteurs.
GRAFMEYER Yves (1994), Sociologie urbaine, Nathan, coll. 128, domaine : Sociologie, Paris.
Dans ce déjà classique aperçu de sociologie urbaine, les dix pages consacrées aux « manières d'habiter et usages de la ville » forment l'exposé le plus clair qui soit à la compréhension de l'appropriation de la ville, du fameux rapport entre la proximité sociale et la distance spatiale, des processus ségrégatifs, de l'effet de contexte. Plus largement, les trois chapitres sur les différenciations, le peuplement et la socialisation parcourent les grandes interrogations posées par l'École de Chicago avant d'être reformulées par les sociologues français.
GIARD Luce, MAYOL Pierre (1980), L'invention du quotidien, t.2, Habiter, cuisiner, UGE, coll. 10/18, Paris ; rééd. complétée 1994, Gallimard, coll. Folio Essais, Paris.
En ethnologie urbaine, comme exemples de talent d'observation, d'interprétation et d'écriture, il y a Olivier Schwartz (1990), et aussi Luce Giard et Pierre Mayol à propos du légendaire quartier lyonnais de la Croix-Rousse. Ils suivent une voie originale à partir des jalons posés par la sociologie de la vie quotidienne d'Henri Lefebvre et par l'anthropologie de l'inclassable Michel de Certeau, le premier (marxiste) et le second (chrétien) étant convaincus de l'« activité créatrice des pratiquants de l'ordinaire ». Bien que P. Mayol en ait décrit l'habiter et L. Giard le « cuisiner », le quartier est présenté comme une privatisation de l'espace public, comme une solution de continuité entre l'intime du domicile et l'inconnu de la grande ville, si bien que le dedans et le dehors ressortissent à un même habiter. La nourriture y illustre la métaphore du dedans et du dehors : de même qu'elle est incorporée et rejetée par le corps, sa préparation et sa consommation placent le logement entre le quartier et le chez-soi, entre les autres et la famille.
JOSEPH Isaac (1983), Présentation et traduction de Ulf HANNERZ, Explorer la ville. Éléments d'anthropologie urbaine [1980], Ed. de Minuit, coll. Le Sens commun, Paris.
Avec cette introduction à l'exploration de la ville par un anthropologue interactionniste qui présente et discute les travaux de l'École de Chicago, I. Joseph présente lui-même l'interactionnisme en posant les éléments du débat théorique : anthropologie de la ville ou dans la ville, de la ville ou du citadin, des institutions ou des acteurs ? Anthropologie de l'urbanité et de ses acteurs, répond I. Joseph, qui introduit les notions de situation et de rôle, l'étranger apparaissant comme le citadin par excellence, c'est-à-dire celui qui trouve sa liberté dans l'air de la ville, celui dont le vécu urbain est le plus déterminé par l'expérience des situations.
LEGER Jean-Michel (1990), Derniers domiciles connus. Enquête sur les nouveaux logements, 1970-1990, Ed. Créaphis, Paris.
Parler d'« expérience » à propos de l'architecture du logement des années 1970-1990 doit être compris davantage comme l'aventure sentimentale des architectes que comme la mise au point d'essais dans un laboratoire social. Les excès de la carte blanche donnée aux architectes ne doivent pas pour autant conduire à jeter le bébé de l'architecture expérimentale : depuis 1920, si l'on peut parler de progrès dans le logement populaire, c'est aux électrons les plus libres qu'on le doit. Les habitants du logement social auxquels on a attribué ces logements pas ordinaires n'ayant pas été consultés avant, la puissance publique a eu la courtoisie de les solliciter après occupation, dans des procédures de Post-occupancy evaluation qui ont parfois permis de trier la bonne innovation de la mauvaise. L'ouvrage fait ainsi le bilan de ces Vingt (pas très) Glorieuses, la propre expérience d'enquêteur de l'auteur étant complétée par l'analyse secondaire de plusieurs dizaines d'opérations. La démocratie demeurant le moins pire des systèmes, la parole des habitants y est traduite avec la trahison induite par la mise en perspective de ces centaines de témoignages. L'existence, parmi la population habitante, de plusieurs axes focaux oblige à varier les recommandations : si les exigences en faveur de la qualité technique de la fabrication du logement et envers les pratiques discrètes (rangement et soins du linge) sont universelles, les autres pratiques et usages symboliques répondent à des classements de type bourdieusien qui appellent chacun des réponses situées.
PINSON Daniel (1988), Du logement pour tous aux maisons en tous genres, Plan Construction et Architecture, coll. Recherches, Paris.
Dans le sillon nantais tracé par M. Verret (1979, D. Pinson creuse la question de l'habitat ouvrier. Par l'observation ethnographique des lieux d'habitat, il décèle des singularités qui s'écartent du modèle d'un habitat ouvrier uniforme et, d'abord, d'un ouvrier uniforme à l'usine. Quant à la singularité de l'auteur, elle est dans sa méthode, qui associe à l'entretien approfondi des relevés détaillés des espaces et des objets de la maison (relégués évidemment en annexe par l'éditeur paresseux), tout n'étant pas dit par la parole. Cette prise en compte du non-dit, mais du visible, sinon du montré, accuse la différenciation entre le logement « hétéronome » (en immeubles collectifs ou en maisons sur catalogue) et la production autonome de la maison. Pour D. Pinson, le mode d'habiter ouvrier se qualifierait toutefois moins par l'opposition entre les modes d'habitat, collectif ou individuel, que par des modèles de consommation dans lesquels le logement n'est qu'un poste de dépense en balance avec les loisirs, notamment. Certes, l'accession effective à la propriété (ou son projet) domine, mais D. Pinson rappelle les réalités plurielles (maison autoconstruite, sur catalogue, réhabilitée) de ce rêve commun fondées, aussi, sur un besoin de création que le travail n'assouvit pas.
RAYMOND Henri (1984), L'Architecture, les Aventures spatiales de la Raison, Centre de Création industrielle-Centre Georges-Pompidou, coll. Alors, Paris.
On suit dans cet ouvrage les raisons de l'aventure intellectuelle d'H. Raymond, qui fut l'un des tout premiers sociologues à s'adresser aux architectes et le premier à étudier l'architecture comme un concept. H. Raymond emprunte à l'esthétique (Kant), à la sociologie (Gurvitch), à la sociologie de l'art (Francastel), à la linguistique (Chomsky), à la théorie architecturale (Tafuri) et refonde les concepts d'espace de représentation et de type architectural afin d'expliquer les relations entre l'architecture et la société. Pour ce qui regarde plus spécifiquement les modes d'habiter, il revient sur la méthode d'analyse de l'espace habité mise au point pour Les Pavillonnaires (CRU, 1966). L'existence, le sens et la légitimité de la parole de l'habitant sur son espace doit, elle, à Lévi-Strauss, à partir duquel H. Raymond révèle la correspondance entre des termes spatiaux et matériels de l'habitat et des termes sociaux et moraux. En énonçant ce que l'espace veut dire, H. Raymond démontre l'existence d'un « système pratico-symbolique » de l'habiter, qui, pour la connaissance scientifique des modes d'habiter, demeure l'apport majeur des trente dernières années.
SINGLY François de (1998), Habitat et relations familiales. Bilan, Plan Construction et Architecture, coll. Recherches n° 90, Paris.
L'étude de la famille nucléaire dans le logement a été dominée par la notion de rôle qui impliquait une spécialisation des espaces. La cuisine était réputée le domaine de la femme (de même que la chambre conjugale), les enfants étant répartis dans les chambres selon une double logique de division par sexe et par âge, l'homme s'attribuant le bureau, quand il y en a un, la cave ou le garage, quand ils existent, et donc rien si les trois font défaut, d'où l'importance bien connue du dehors pour l'homme (rafraîchie par O. Schwartz, 1990), qui n'est pas contradictoire avec l'enfermement dans les WC constaté par Welzer-Lang et Filiod (1993). F. de Singly, sociologue de la famille, pousse la porte du logement en se demandant comment la pratique des relations de tous ces personnages, simultanément ou séparément, donne la place, et le sens de la place de chacun dans le logement. Le décentrement de son point de vue modifie notablement la vision du logement. Éclairée par les relations familiales, sa lecture fait bouger dans l'espace (et dans le temps) ce qui, jusqu'alors expliquait les pratiques de chacun pris séparément ou bien les pratiques de groupe (repas, fêtes) observation obligée des ethnologues. Il propose de se demander ce que fait ensemble ou séparément le couple conjugal, ou bien le collectif familial, pour une définition dynamique de la cohabitation. Le débat sur la cuisine ouverte ou fermée est exemplaire de ces exigences contradictoires, la cuisine pouvant être successivement préférée ouverte puis fermée. L'étude des pratiques dans l'espace glisse ainsi naturellement vers leur étude dans le temps, la configuration des relations impliquant le rythme du jour, de l'année, du cycle de vie – exemple : le statut de la chambre après le départ de l'enfant, révélateur du lien conjugal et indicateur du lien intergénérationnel. Après avoir considéré combien la vie publique (l'école, notamment) pénètre dans le logement et combien des espaces publics (de sport, par exemple) peuvent être privatisés, F. de Singly invite enfin à déplacer notre curiosité sur l'ensemble des situations de double résidence qui intéressent aujourd'hui davantage la presse que la recherche.
SCHWARTZ Olivier (1990), Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, PUF, coll. Pratiques théoriques, Paris.
Parti d'une enquête ethnographique, O. Schwartz décrit finalement le basculement de la classe ouvrière du bassin minier comme une véritable dramaturgie socio-anthropologique. L'implication de l'auteur dans son terrain, sa maîtrise des concepts forgés, l'enthousiasme de son écriture sont mis à la hauteur du destin de cette classe, restitué à travers ses liens (la conjugalité, la parentalité), ses figures (la mère, l'homme, le couple, les fils), ses lieux (la maison, le dehors). Les portraits, habituels en ethnologie, sont ici proprement héroïques. En montrant comment la vie privée ouvrière ne coïncide pas avec la vie familiale, et que la conquête du monde privé est autant le terrain d'émancipation que celui de la dictature de la vie quotidienne, O. Schwartz apporte une contribution théorique majeure aux statuts du moi, du chez-soi, de la vie privée. Peut-elle être transposable aux couches moyennes précarisées ?
VERRET Michel (1979), L'espace ouvrier, Ed. Armand Colin, coll. U, Paris ; rééd. L'Harmattan, coll. Logiques sociales, Paris, 1995.
Ce classique de la sociologie « ouvrière » est-il son chant du cygne ? Écrit au milieu des années 70, soit au début du déclin de la classe ouvrière, en tant que classe et en tant que catégorie sociale, il en exprime brillamment la misère et la grandeur des conditions de vie. Les données quantitatives et qualitatives réunies par M. Verret dessinent un portrait complet des espaces ouvriers : le logement, bien sûr, mais aussi l'espace public et celui des vacances, après être revenu sur l'histoire des conditions de logement des derniers de la classe. Le parti pris de M. Verret montre, une fois de plus, que l'objectivité est peut-être une qualité pour les opticiens, mais pas pour les sociologues.
WELZER-LANG Daniel, FILIOD Jean-Paul (1993), Les hommes à la conquête de l'espace... domestique. Du propre et du rangé, VLB éditeur-Le Jour éditeur, coll. Des hommes en changement, Montréal.
Deux anthropologues hommes parlent des hommes dans le logement, ce qui en soi est déjà nouveau. Certains n'ont retenu de leur travail qu'une de leurs interprétations de la répartition des espaces : les femmes à la cuisine et les hommes aux WC – chacun donc à une extrémité du tube digestif. Le lecteur homme ayant du mal à digérer cette hypothèse se reconnaît de toute façon dans les pratiques de propreté et de rangement soigneusement mises à nu. Comme Jean-Claude Kaufmann dans La Trame conjugale (Nathan, 1992), ils serrent de près ce moment-clef qu'est l'installation du couple, confrontation de modèles sociaux et sexués du propre et du rangé. Leur contribution pose la question, rémanente, de l'évolution des modèles : la volonté de certains hommes de vivre autrement les relations hommes-femmes peut-elle faire bouger les modèles ?
Si vous souhaitez acquérir le livre
Logement et habitat, bibliographie commentée est disponible à la Librairie Le Genre urbain ou bien à la Documentation française