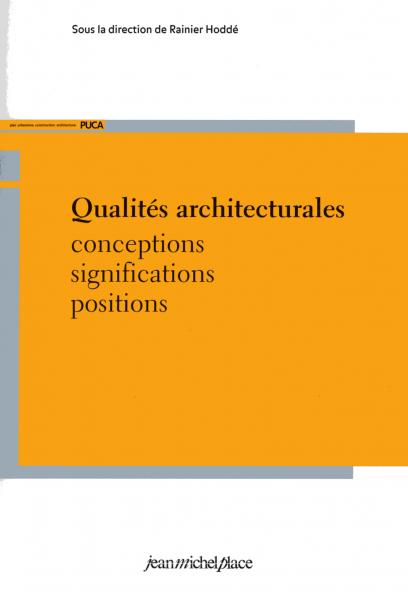« L’invitation au voyage. Import-export d’architectures du logement en Europe », in Rainier Hoddé (dir.), Qualités architecturales. Significations, conceptions, positions, Paris, Ed. Jean-Michel Place, 2006, p. 111-123.
Table des matières de l'ouvrage (PDF)
Texte intégral de l'article
En 1995, l’exposition et le catalogue que André Lortie consacrait, notamment, à l’exportation de l’urbanisme haussmannien, révélait que l’empreinte du baron à travers le monde s’inscrivait dans le vaste mouvement des emprunts et des influences qui, des châteaux forts aux gratte-ciel en passant par les percées, ont modelé nombre de villes dans le monde (Lortie 1995). Les récentes interrogations sur les échanges entre le Brésil et la France ont montré elles aussi que les relations avec l’hémisphère sud pouvaient être à double sens, lorsque la modernité brésilienne séduisait les architectes de Royan après avoir été elle-même séduite par Le Corbusier (Ragot, Nogue 2003). Si l’activité des architectes hors de leurs frontières, qui date de la Renaissance, prend son essor dans le XIXe siècle colonialiste, la facilité offerte au XXe siècle par les transports ouvre des perspectives de voyages tels que ceux de Le Corbusier et Jeanneret à Chandigarh et ceux de Aalto aux Etats-Unis. Enfin, au tournant de notre siècle, la mondialisation substitue aux échanges bilatéraux un vivier de Top Ten plus ou moins interchangeables dans lequel puisent les commanditaires capables d’être des interlocuteurs du même monde.
La commande de logements échappe toutefois en grande partie à cette circum navigation, comme si la notion de “ domestique ” (au sens où on l’entend dans les aéroports) reconnaissait à l’architecture du même nom une spécificité culturelle, pour ne pas dire une spécialité nationale, voire régionale, inexportable en tout cas. Que sait-on de cette commande ? Le courant de recherche qui explore l'évolution du métier d'architecte s’intéresse davantage à l’organisation du travail qu’aux formes produites , d’où notre curiosité pour une restitution du travail de projet qui participe à une analyse compréhensive de l'action et du cadre de références d’architectes face à leurs clients et aux exigences des réglementations locales. Il s’est agi de comprendre les raisons de la commande de logements “ import-exportés ” avant de questionner les conditions de leur conception et de leur réalisation, puis, enfin, celle de leur réception. L’intensité des interactions n’efface pas la primauté de la position de l’acteur dans le système conception/production, ce qui oblige à une restitution par “ corps d’état ” séparés : maîtres d’ouvrage, architectes et habitants, le point de vue de la critique architecturale ayant sa propre logique en nouant des alliances tantôt avec les architectes, tantôt avec les usagers – il n’y a pas de paradigme unitaire de la réception. Comme en photographie, l’ouverture de l’angle de vue a accru la profondeur du champ observé, au prix d’une dispersion des objets étudiés en France et aux Pays-Bas, œuvres d’architectes français, portugais et suisses , ce qui oblige à la prudence dans l’interprétation de résultats à considérer comme exploratoires.
Maîtres d’ouvrage : reprendre l’avantage
Le discours officiel des maîtres d'ouvrage qui font appel à des concepteurs étrangers, par voie de concours ou par commande directe, affiche une attente de renouvellement des réponses et de savoir-faire, le prestige de la signature étrangère pouvant être aussi un moyen de mobiliser les autres acteurs (élus et fonctionnaires) de manière à réaliser une opération exceptionnelle dans un contexte de compétition entre élus, entre villes et même entre nations.
L’adaptation ou la transcription du projet de l’architecte par le bureau d’études, qui est la règle dans tous les pays, est davantage encadrée aux Pays-Bas, où les usages établissent que la mission de l’architecte se limite à une prestation intellectuelle de conception du projet, sans responsabilité de suivi du chantier. Les opérations de réécriture y sont plus nécessaires encore lorsque le projet est l’œuvre d’un étranger supposé ignorer les règles administratives et les méthodes constructives néerlandaises. Nécessaires pour le maître d’ouvrage mais obligées pour l’architecte n’ayant d’autre choix que de se ranger aux exigences que son commanditaire a tôt fait de présenter comme le dépassement d’une “ incompétence ” légitimée par la situation d’extranéité. Dans un invariant culturel qui, à l’intérieur du trinôme maîtres d’ouvrage/architectes/entreprises, fait de l’incompétence de l’autre un ciment des identités professionnelles respectives, l’extranéité de l’architecte invité légitime pour le maître d’ouvrage néerlandais le renforcement du partage des compétences. Plus que d’“ incompétence ”, faudrait-il d’ailleurs parler d’“ incapacité ”, au sens où l’entend le droit des mineurs, l’architecte étranger se trouvant incapable de jouer selon la règle du jeu néerlandais. Et, plus que l’ignorance de la réglementation néerlandaise, faudrait-il évoquer celle des manières de négocier, c’est-à-dire d’argumenter, d’établir des compromis, qui supposent à la fois de la disponibilité, de la mobilité et de la subtilité. Or, l’éloignement géographique n’est jamais suffisamment compensé par la réévaluation des honoraires de l’architecte et les finesses linguistiques ne sont pas toujours traduites par l’emploi de l’anglais ou de l’allemand, que, au demeurant, les acteurs néerlandais maîtrisent mieux que la plupart de leurs partenaires architectes européens. L’étranger se trouve ainsi incapable de partager de plain-pied la fameuse culture du consensus, réputée être la clef de voûte du fonctionnement des institutions publiques et privées néerlandaises.
La pratique du consensus est cependant coûteuse en temps de négociation. Ainsi, face au paradoxe d’un consensus autant prôné que déploré, le recours à des architectes étrangers apparaît comme un moyen de se décentrer, c’est-à-dire de bénéficier d’une architecture reconnue et renouvelée tout en assurant à la maîtrise d’ouvrage le maintien du cap malgré la négociation. Le commanditaire néerlandais confine alors plus strictement la mission de l’architecte étranger à la livraison d’une prestation de concept sans avoir à négocier les modalités d’adaptation et d’exécution comme il est supposé le faire avec un architecte national.
L’exemple des trois opérations commandées à des équipes helvétiques par la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) tend à montrer que, en France aussi, l’appel à un étranger renommé peut-être pour le maître d’ouvrage une manière de dynamiser la division du travail séparant conception et exécution du projet. La demande de créativité, explicitement formulée par les élus et les maîtres d’ouvrage néerlandais pour motiver leur appel à un architecte venu d’ailleurs, a été exprimée de manière identique par la RIVP. La différence est dans la traduction du projet par le bureau d’études : clairement annoncée aux Pays-Bas, alors que les trois équipes suisses ont été très surprises de la furia francese de l’administration parisienne et que le maître d’ouvrage se fut offert le beau rôle en leur donnant prétendument carte blanche. Ce ne sont pas les bureaux d’études qui les ont attendus au coin de la rue mais les administrations chargées de faire entrer, sans ménagement, le projet dans le cadre réglementaire. Toutefois, l’inégalité de traitement infligée à chacune des trois équipes suisses n’est pas tant dans la réponse des administrations que dans la suite qui a été donnée à leurs avis : or, on ne peut pas ne pas être étonné de la différence de traitement apportée aux trois projets de Vacchini, Diener & Diener et Herzog & de Meuron. Vacchini, artisan malgré sa réputation internationale, a dû refaire plusieurs fois sa façade de la rue Albert ; même chose, rue de la Roquette, pour Diener & Diener, à la dimension de PME à l’époque (1993) alors que, en 1996, Herzog & de Meuron, non encore “ pritzkerisés ”, constituaient déjà une multinationale non pas par leur chiffre d’affaires et le nombre de leur collaborateurs mais par la capacité du “ bureau ”, comme on dit en Suisse, à réaliser des projets à Bâle, à Londres ou en Californie et à faire valoir son point de vue. Aujourd’hui, ce sont Herzog & de Meuron qui choisissent leurs clients et non l’inverse, ce qui modifie assurément la géométrie de la négociation. Serait-ce une manière d’expliquer pourquoi leur projet de la rue des Suisses a été accepté malgré l’hostilité du voisinage et celle de la critique architecturale parisienne ?
Ainsi, pourrait-on dire que, pour un maître d’ouvrage, la plus grande efficacité de l’importation d’un projet serait assurée par un architecte dont la notoriété serait inversement proportionnelle à son chiffre d’affaires. L’architecte ne serait-il alors qu’une victime consentante sur le marché concurrentiel du travail ?
Architectes/règlements : les surprises de la terra incognita
Partout, le statut d’auteur de l’œuvre est reconnu aux architectes, quelle que soit la distribution entre acteurs de la production. Aux Pays-Bas, le partage des rôles entre maître d’ouvrage et architectes limite la responsabilité de ces derniers, mais pas la reconnaissance de leur rôle, si bien que, entre la France et les Pays-Bas, on ne perçoit de différence ni dans l’individualité de la signature ni dans la place occupé par l’architecte dans la culture architecturale contemporaine. Ne faut-il pas s’étonner d’une telle personnalisation du rôle de l’architecte, au moment où la complexification des processus de conception et de construction a tendance à partager les compétences, et donc à réduire le rôle de l’architecte (Champy 2001) ? Non, parce que, en survalorisant la place de l’architecte, les maîtres d’ouvrage valorisent justement la leur en partageant leur prestige (Biau 1998). Il reste à comprendre les raisons du mirage présenté par l’étranger.
On se souvient que, sans quelque ingratitude, Alvar Aalto avait baptisé son bateau Nemo Propheta in Patria ; toute proportion gardée, Massimiliano Fuksas est devenu prophète en Italie après avoir bâti sa carrière en France : la reconnaissance par l’étranger appartient à l’imaginaire de l’architecte comme à celui de l’artiste et contribue à l’illusion que la position du premier doit toujours quelque chose à celle du second. C’est bien d’illusion dont il est question dans les deux témoignages suivants, par exemple, l’un exprimé avant un projet exporté, l’autre après. Avant : “ Un autre pays me permet une liberté que je ne ressens plus ici, car je n’aborde plus mes projets français avec la même fraîcheur, comme si je connaissais d’avance la censure. ” (Henri Ciriani in Devillers, 1989 : 9). Après : “ Construire dans un pays étranger, c’est un peu vivre une relation amoureuse clandestine. On est fasciné par l’exotisme d’une autre culture jusqu’à ce que l’on découvre que la qualité de la construction à laquelle on peut parvenir dans son propre pays grâce aux connaissances que l’on a de la culture locale est pratiquement irréalisable à l’étranger. Une fois à la maison, on a l’impression de prendre une douche froide et l’on a perdu beaucoup de temps et d’argent ” (Josep Lluís Mateo in Haumont 1997). Un tel paradoxe n’est que l’expression de nombre d’expériences humaines qui sont incompréhensibles tant que l’on se borne à n’y voir que des logiques d’intérêt. Or, tout projet est une “ aventure ”, terme dont le galvaudage ne devrait pas enlever sa pertinence à rendre compte du risque et de l’incertitude inhérents à tout projet architectural.
Si la commande exportée est une rupture (positive ou non) dans le parcours professionnel, qu’en est-il de la continuité/rupture dans la poursuite de thèmes architecturaux ? Le concept de thème architectural articule des problèmes matériels et des attentes plus symboliques. Il introduit également une relation consubstantielle avec la répétition au regard de l’ensemble de l’œuvre d’un architecte, l’innovation n’étant plus la nouveauté perpétuellement renouvelée, mais plutôt la déclinaison itérative de thèmes (Conan 1988). Ces thèmes, qui permettent de penser la constitution d’une œuvre dans la dynamique, à la fois créative et répétitive, propre à chaque architecte, passent-ils les frontières ? Que devient alors le contexte, dans un temps où chaque architecte revendique de s'inscrire dans le contexte où il intervient ?
L’analyse révèle que les projets exportés sont tous des montages entre une permanence des thèmes propres aux architectes et une prise en compte des traditions architecturales du lieu. Les différents projets dessinés par Henri Ciriani pour les Pays-Bas (réalisés à La Haye, restés sans suite à Groningue et Nimègue) continuent tous le thème de l'immeuble-villas après les réalisations précédentes de La Noiseraie et d’Évry-Courcouronnes, la petite tour de La Haye se distinguant par une compacité volumétrique qui doit tout à la réglementation thermique néerlandaise.
La continuité des thèmes architecturaux la plus remarquable est celle que réalisent Herzog & de Meuron dans le programme de la rue des Suisses (Paris-XIVe), puisqu’ils y citent ouvertement deux de leurs premières œuvres bâloises. Les thèmes de la maison en bois construite dans une cour de la Hebelstrasse (1984-1988) y sont repris dans le bâtiment en fond de cour (volume long et bas, balcons en bois, plans mono-orientés ), tandis que les volets de fonte de l’immeuble sur la Schützenmattstrasse (1984-1993) préfiguraient les persiennes d’aluminium déployées sur la façade de la rue des Suisses.
Chez leurs confrères bâlois Diener & Diener, le rôle de la fenêtre dans l’architecture est une permanence depuis l’immeuble de la Hochstrasse (1985-1988), qui inaugurait le thème de la fenêtre comme “ trou dans un mur ”, pour signifier l’épaisseur du bâtiment dans l’espace et dans le temps. Ce thème, qui a donné lieu à enseignements, expositions et applications régulières dans les projets européens avec une relative indifférence au programme (logements, bureaux, écoles), exacerbe la “ puissance expressive de la non-expression ” des bâtiments (Abram 1997 : 25). C’est bien ce qu’ont déploré les critiques français et, d’abord, les différents services de l’administration parisienne , qui ont contraint Diener & Diener à casser leur thème et à substituer à leurs premières ouvertures en longueur des fenêtres vaguement à la française, lesquelles, au bout du compte, ne sont ni classiques ni modernes. Mais le plus déroutant reste Siza, qui, pour ses projets de La Haye, s’est mué en “ Hollandais plus que parfait ” (Robert 1989 : 56). Contrairement aux attentes de ses commanditaires, qui imaginaient une architecture abstraite et blanche égale à celle de ses projets de Porto, Évora et Berlin, il a recomposé deux quartiers dégradés en donnant une leçon à partir de la tradition architecturale et urbanistique hollandaise : même volumétrie, même revêtement de brique, mêmes maisons au toit à deux pentes, sage interprétation du Haags portiek (l’entrée d’immeuble typique).
Habitants : ouverts à l’architecture sans frontière
Dans chaque pays, la correction des projets par les maîtres d’ouvrage tend à réduire les traits culturels les plus spécifiques des architectes, quand ce ne sont pas les architectes eux-mêmes qui se moulent dans ce qu’ils supposent être les conventions architecturales de leurs hôtes. De leur côté, sur le marché de l’offre, les habitants sont confrontés à une dispersion typologique telle que le logement “ normal ” ou “ moyen ” est, de fait, très minoritaire. A la livraison, il n’y a donc plus de logement français, suisse, italien ou portugais. Le “ plan bâlois ” initialement proposé rue des Suisses (distribution par couloir inversant la partition jour/nuit à la française, pièces toutes de taille équivalente) a été révisé dans le sens d’un retour à la hiérarchie des pièces. Rue de la Roquette, les premières ouvertures dessinées par Diener & Diener étaient des fenêtres en longueur, mais la pierre parisienne était d’emblée au programme. A La Haye, les habitants de la tour de Ciriani se sont bien demandés si le hall monumental, la terrasse de devant et le jardin d’hiver étaient français, mais ces trois dispositifs, même jamais vus auparavant, ont convaincu les habitants par leur pertinence à répondre à des usages pratiques et symboliques.
L’ajustement entre les usages et les espaces – du moins dans les cas étudiés – ne procède pas de la mécanique, mais davantage d’un processus langagier dans lequel usages et espaces travaillent en réciprocité. Certes, toutes les configurations spatiales ne sont ni acceptables ni acceptées, preuve en est que la suppression (due à la réglementation anti-incendie) de portes coulissantes prévues par Edith Girard oblige les habitants à bricoler des occultations et le maître d’ouvrage à louer ses appartements à des ménages sans enfant. A ces conditions, ces appartements sont de très beaux trois-pièces de 85 m2, l’absurdité d’une telle suppression devant cependant être replacée dans la double perspective de la commande (les expérimentations du Festival du Logement ) et de la situation du parc de ce bailleur, lequel a la capacité de choisir ses locataires.
En revanche, l’originalité objective (pour des Français) du plan bâlois n’est pas reçue comme telle par les habitants qui dénoncent celui-ci seulement lorsque, dans telle adaptation de ce type rue de la Roquette, ils sont confrontés à un couloir représentant à lui seul 15 % de la superficie du logement. L’inversion de la partition jour/nuit à la française n’y est pas relevée, ce qui tend à contredire la permanence du “ type collectif contemporain ” décrite par Bernard Huet (Huet 1990) et recommandée par la majorité des maîtres d’ouvrage. Quant aux habitants de la rue des Suisses, ils bénéficient des conditions exceptionnelles offertes à Herzog & de Meuron par la RIVP, qui font que, par exemple, la taille d’un cinq pièces rue de la Roquette est celle d’un quatre pièces rue des Suisses – du moins dans le bâtiment situé en fond de cour –, sans compter la valeur ajoutée des fameux balcons et volets roulants en bois, certes plus consensuels que les non moins célèbres persiennes d’aluminium plissé des deux bâtiments sur rue. Les processus de réception des dispositifs architecturaux intérieurs et extérieurs et des matériaux mis en œuvre dans les opérations import-exportées n’ont ainsi rien de spécifique.
Conclusion
Dans le marché concurrentiel de l’architecture, y compris de celle du logement, les architectes sont ouverts à toute commande, d’où qu’elle vienne et quel qu’en soit le coût. Du côté de la maîtrise d’ouvrage aussi, la rupture avec les pratiques routinières donne l’illusion d’un renouveau, par-delà l’éblouissement du prestige de l’import-export. L’aveuglement le plus durable est subi par les architectes : leur mission est rognée, de facto ou de jure, et la plus ou moins grande distance géographique et culturelle est exploitée par les maîtres d’ouvrage qui doublent l’avantage du prestige en renforçant leur rôle par une fragilisation de celui de l’architecte. Comme tout héritage national, la culture du consensus est pour les maîtres d’ouvrage une norme dont ils peuvent souhaiter s’affranchir pour gagner du temps et pousser leur avantage : l’appel à un étranger permet de sortir non explicitement de ces règles. Pourquoi faudrait-il toutefois rompre avec les pratiques routinières ? L’import-export d’architecture du logement appartient à la dynamique de l’innovation qui, depuis 1945, est davantage mue par les architectes, les entreprises et les pouvoirs publics que par les maîtres d’ouvrage qui, certes, encourent le plus de risque – quoique pas tant que les habitants, les mieux ou les plus mal placés, en première ligne. L’intention d’innovation motive toujours les maîtres d’ouvrage et les élus ; les architectes eux aussi chargent le projet exporté d’une même intention, mais la nouveauté représentée par l’exportation peut conduire à une distorsion du sens de l’innovation qui aboutit à des paradoxes. Invité à La Haye, Siza renouvelle sa pratique par une interprétation méthodique de l’architecture néerlandaise, que ses commanditaires n’attendaient pas. En revanche, Ciriani, É. Girard, Diener & Diener, Herzog & de Meuron ou Vacchini ont continué à l’étranger leur exploration de typologies déjà commencée dans leur pays respectifs, ce qui ne veut pas dire pour autant que leurs projets tendent à l’universalité. L’opération réalisée par Herzog & de Meuron rue des Suisses est la plus remarquable par la manière dont elle se place “ entre la continuité pittoresque de l’architecture urbaine et la dislocation de la ville par les modernes ” (Lapierre 2000 : 135), mais, dans l’ensemble, tous les projets import-exportés se distinguent autant par leur référence au contexte que par leur valeur d’universalité. La meilleure validation de l’apport des architectes étrangers est fournie par la réception de ces opérations par leurs habitants, qui se préoccupent de l’habitabilité et de la respectabilité – et donc de la “ qualité ” – de leur logement et de leur immeuble sans se soucier du passeport de leurs concepteurs. A l’instar de la bonne ou mauvaise fortune de toute opération innovante, les habitants ne demandent ni ne refusent l’importation de projets venus de l’étranger, dont la pluralité est une particularité de la syntropie de l’architecture d’aujourd’hui, toujours plus complexe et différenciée, loin d’une modernité qui apparaît de plus en plus comme une référence historique centrée sur elle-même. Enfin, en ultime leçon livrée par les modalités de la réception de l’architecture et contrairement à ce qui a souvent caractérisé l’architecture innovante des décennies précédentes, les opérations de Diener & Diener et de Herzog & de Meuron ont davantage divisé la profession et l’administration que les habitants. L’opposition entre réception cultivée et réception populaire peut donc être dépassée par des divergences à l’intérieur des publics, ce qui est largement attesté par la plus petite attention portée à une critique architecturale volontiers fratricide.
Bibliographie
ABRAM, J. (1997), “ Un caractère intemporel. A propos de l'immeuble de la Roquette à Paris ”, Faces, n° 41, été, p. 22-21.
BIAU, V. (1998), “ Rêves et aléas de l’architecte-artiste ”, in HAUMONT, N. (dir.), L’urbain dans tous ses états. Faire, vivre, dire la ville, Paris, L’Harmattan, p. 89-102.
CASTRO, R. (2002) “ Coup de gueule ”, D’Architectures, n° 118, février, p. 54.
CHAMPY, F. (2001), Sociologie de l’architecture, Paris, La Découverte.
CONAN, M. (1988), Frank Lloyd Wright et ses clients. Essai sur la demande adressée par des familles aux architectes, Paris, Plan construction et architecture.
DEVILLERS, Ch. (1989), “ Ciriani, quatre tours en Hollande ”, L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 266, décembre, p. 9-13.
DIENER, R. (1989), “ Sur le processus conceptuel du projet d’architecture et les moyens qu’il implique ”, in BARBEY, G., DIENER, R. (dir.), Fenêtres habitées/Die Wohnung im Fenster, Bâle, Architekturmuseum in Basel, p. 32-41.
HAUMONT, B. (1995),“ Maîtrise d'œuvre : une comparaison européenne ”, Urbanisme, n° 285, nov.
HAUMONT, B. (1997), “ Approche sociologique des projets ”, in PROST R. (dir.), Europan, concours d’architecture : des idées aux réalisations, Plan construction et architecture, juillet (n. p.).
HAUMONT, B. (1998), “ La maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine en Europe : des modèles contrastés d’organisation et de gestion ”, in HAUMONT, N. (dir.), L’urbain dans tous ses états. Faire, vivre, dire la ville, Paris, L’Harmattan, p. 17-29.
HAUMONT, B. (1999), “ Etre architecte en Europe ”, Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, n° 2/3 “ Métiers ”, novembre, p. 75-84.
HAUMONT, B., BIAU, V., GODIER, P. (1998), Les professions et les métiers de l'architecture et de la conception en Europe, Plan urbanisme construction architecture.
HUET B., LAMBERT M., TOUSSAINT, J.-Y. (1990), Le logement collectif contemporain, Paris, Plan construction et architecture.
LAPIERRE, É. (2000), “ La ville contre l’architecture ”, Le Moniteur Architecture AMC, n° 112, décembre 2000-janvier 2001, p. 132-135.
LORTIE, A., dir. (1995), Paris s’exporte. Modèle d’architecture ou architectures modèles, Paris, Pavillon de l’Arsenal / Picard.
LUCAN, J. (1997), “ Une architecture urbaine objective ”, Le Moniteur Architecture AMC, n° 78, mars, p. 30-35.
PROST, R. (1995), Concevoir, inventer, créer. Réflexions sur les pratiques, Paris, L'Harmattan.
PROST, R. (1999), “ Les pratiques architecturales en mutation ”, Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, n° 2/3 “ Métiers ”, novembre, p. 85-94.
PROST, R., dir. (1997), Europan, concours d’architecture : des idées aux réalisations, Plan construction et architecture.
RAGOT, G., NOGUE, N., dir. (2003), L’invention d’une ville. Royan années 50, Paris, Ed. du Patrimoine.
ROBERT, J.-P. (1989), “ Siza à La Haye. Maître et modèles ”, L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 261, février, p. 54-59.
Si vous souhaitez acquérir le livre
Qualités architecturales est disponible à la Librairie Le Genre urbain ou bien sur Amazon