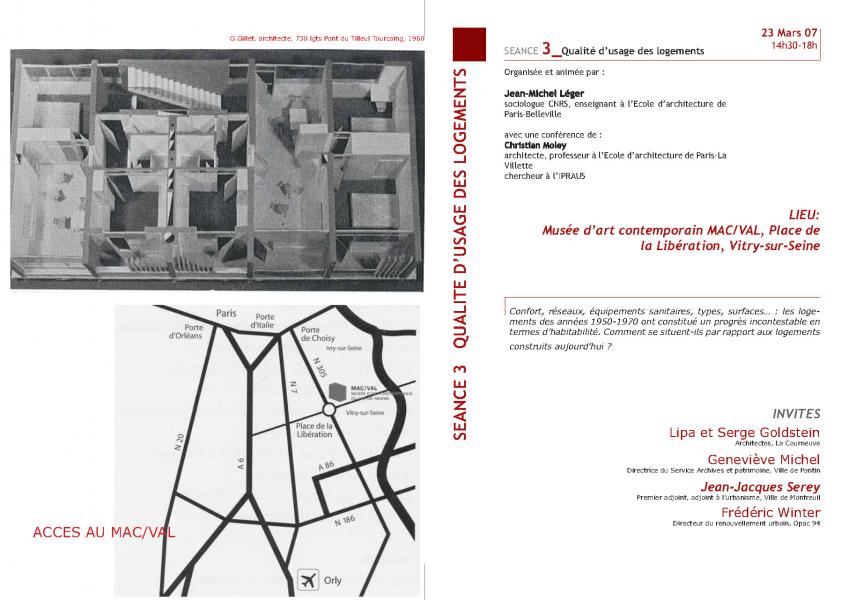"Label XXe". Séminaire pour la définition de critères de reconnaissance du logement social comme patrimoine du XXe siècle, 2007.
Présentation du séminaire (PDF)
Objectifs du séminaire
Objectif
La direction des Affaires culturelles d’Ile-de-France souhaite que soit élaborée une méthode d’évaluation architecturale et urbaine du patrimoine social bâti entre 1950 et 1975, dans le but de fonder un “ Label 20e siècle ” du logement social en Ile-de-France.
A partir du croisement des points de vue de chercheurs (en architecture, urbanisme, technologie du bâtiment et sciences sociales) et d’acteurs (bailleurs, élus, SDAP, CAUE, etc.) impliqués dans la construction, la gestion, la préservation ou la démolition de logements sociaux, il s’agira de construire des critères de qualité selon une méthodologie de diagnostic capable d’être appliquée à la restructuration de tous les quartiers d’habitat social, en premier lieu de ceux visés par la démolition..
D’une telle expérience partagée, à visée pédagogique, il est attendu que la confrontation des points de vue de chercheurs et d’acteurs de terrain contribue à une évolution de la représentation des grands ensembles auprès de ses différents acteurs d’aujourd’hui, en associant des partenaires d’horizons différents, de manière à construire un dispositif de protection partagé, selon une logique différente de celle de l’Inventaire.
Problématique
A la production de masse des années 1950-1975, répondent, dans le cadre des orientations de l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain, des projets de démolition massive fondés sur des expertises souvent hâtives, dépourvues de diagnostic architectural et technique. Depuis trente ans, date de la fin de leur construction, les grands ensembles sont, on le sait, progressivement devenus le syndrome de quelques-uns des maux de la société française, ces quartiers cumulant les échecs du chômage, de l’exclusion et de la différenciation sociale et culturelle (ethnique, ajoutent certains).
Face à un égal échec du débat opposant les déterminations du spatial et celles du social, pour nombre de responsables de la politique de la ville la tentation est grande de charger le spatial d’une responsabilité majeure dans l’expression de ce syndrome, les émeutes de novembre 2005 ayant souligné dramatiquement son acuité sans que les arguments en faveur du spatial ou du social aient progressé.
Or, qu’elles soient rationnelles, cyniques ou désespérées, les raisons avancées pour la démolition de quartiers d’habitat social laissent de côté l’appartenance de certains d’entre eux au patrimoine architectural et urbain de la France : leurs avancées les ont inscrits dans l’histoire de l’urbanisme et de l’architecture. Les historiens de l’architecture citent tous la cité de la Muette à Drancy, les grands ensembles de Marly et de Massy-Antony, du Blanc-Mesnil ou les programmes expérimentaux de Villeneuve-St-Georges . Au-delà de ces quartiers, dont le statut de “ sanctuaire ” n’est pas garanti – et d’ailleurs, ne faut-il pas revendiquer un droit à l’inventaire (sans jeu de mot) réactualisant tous les critères ? –, le travail des historiens doit être élargi aux cercles successifs de la notoriété et confronté aux autres dimensions du patrimoine, sachant que l’expertise sociale (demande des locataires, questions du relogement, etc.) ne relève pas du champ de ce label.
Le cas de Sarcelles, par exemple, montre la nécessité de replacer les réalisations dans l’histoire de leur conception et de leur “ réception ” (terme assez impropre pour qualifier l’usage de l’habitat). Sarcelles, longtemps symbole du mal des grands ensembles (la “ sarcellite ”, oubliée depuis), est depuis quelque temps revalorisé comme grand ensemble singulier parce que régulier (alignement des bâtiments le long de la voirie), les circonstances de sa programmation (premier grand ensemble de la Scic) et la personnalité de ses architectes (Boileau et Henri-Labourdette) n’étant pas pour rien dans la considération dont Sarcelles est l’objet de la part des architectes et des urbanistes. Mais elle est aussi le symbole du mode de vie en grand ensemble, qui a donné lieu à un grand nombre d’ouvrages et de films , sans dire qu’elle est en outre l’un des symboles de la culture juive pied-noir, en tant que porte d’entrée en France après le déracinement de 1962. Le cas de Sarcelles, particulièrement emblématique, certes, de la relation entre des populations et un territoire, révèle donc à lui seul la dimension mémorielle que peut atteindre un tel grand ensemble, au-delà des qualités et des défauts de l’architecture et de la conception urbaine comme au-delà des qualités et des défauts de la vie sociale d’aujourd’hui. Seul un débat exposant les différents points de vue pourrait permettre de hiérarchiser les critères de valeur de Sarcelles, la valeur mémorielle – simple hypothèse – ou, autre hypothèse, celle d’un plan de masse élaboré au coup par coup (Henri-Labourdette ayant refusé de dessiner un plan de masse a priori) paraissant supérieure à la qualité architecturale proprement dite des bâtiments.
A la systématisation de la destruction il ne s’agit pas de répondre par la systématisation de la protection : l’objectif du label est de construire un argumentaire raisonné, appuyé sur des données, une documentation, des témoignages, etc., s’opposant à la passion destructrice qui anime nombre d’élus et de citoyens pas toujours bien informés des questions architecturales et urbaines. La production de cet argumentaire devant les instances instruisant les projets ANRU sera un élément d’expertise dans tous les débats ayant à traiter de la protection/démolition des quartiers.
La démarche s’appuiera sur les travaux d’un certain nombre de commissions et d’initiatives existant en Ile-de-France, la mission conduite par Benoît Pouvreau apparaissant comme la plus avancée .
Un séminaire
Il est ainsi proposé la tenue d’un séminaire, de périodicité mensuelle, janvier à septembre 2007, ouvert à tous ceux qui souhaitent participer au débat de cette problématique, structuré en six séances représentant chacune un descripteur de la qualité de l’habitat social. Chaque séance sera articulée en deux temps : d’abord une série de deux à trois communications de chercheurs pour des exposés synthétiques discutant le descripteur faisant objet de la séance (“ qualités urbaines ”, “ typologie et confort des logements ”, “ procédés constructifs ”, etc.) ; ensuite, une table ronde réunissant un élu, un bailleur, un responsable ANRU, un responsable d’association. L’intervention de chaque élu ne sera pas nécessairement centrée sur la thématique de la séance, mais, plus largement, sur la manière dont la commune fait face à la question du renouvellement urbain.
Organisé par la direction des Affaires culturelles d’Ile-de-France, le Bureau de la recherche architecturale et urbaine (DAPA), l’IPRAUS, laboratoire de recherche de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville
Autres institutions associées : Ecole de la rénovation urbaine, Union Régionale des CAUE, SDAP 93, Conseil général 93, ANRU.
(Texte rédigé avec Béatrice Mariolle et Benoît Pouvreau)