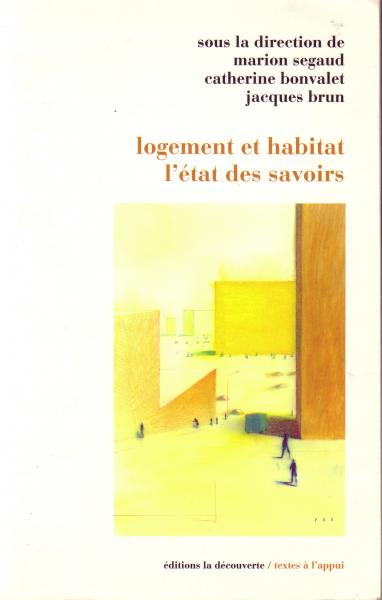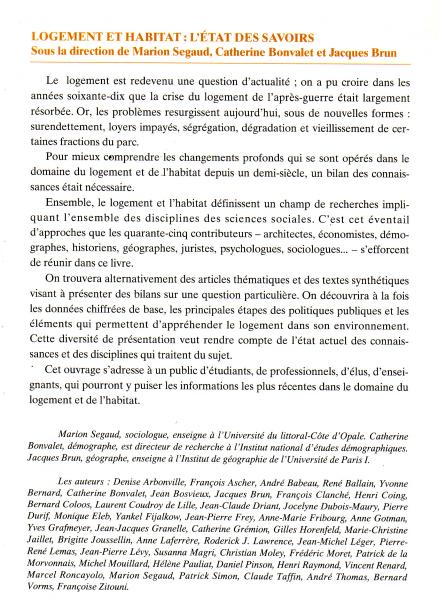« Habiter le logement, habiter la ville », in Marion Segaud, Catherine Bonvalet et Jacques Brun (dir.), Logement et habitat, l'état des savoirs. Paris, La Découverte, 1998, p. 365-373.
Table des matières de l'ouvrage (PDF)
Texte intégral de l'article
Mode, genre, manière, style (de vie, d'habiter)
Paul-Henri Chombart de Lauwe disait avoir appris du pilotage le goût de regarder du ciel l'activité des hommes sur la terre. La suite de sa carrière démontra que, le moment venu, il sut s'en approcher. L'observation des modes de vie pourra ainsi être considérée comme une question de résolution, au sens optique du terme, c'est-à-dire de pouvoir séparateur, quitte à se demander, comme Georges Perec, s'il faut penser avant de classer ou classer avant de penser. Mais d'abord, on doit se souvenir que la notion de mode de vie ne va pas de soi. Bien que Maurice Halbwachs eût montré dès le début du siècle le déterminisme réciproque entre vie de travail et vie hors-travail, la pensée marxiste, longtemps dominante en sociologie, niait la spécificité du mode de vie comme champ d'action. Henri Lefebvre, pourtant marxiste lui aussi, affirmait au contraire que la vie quotidienne n'est pas le simple reflet des positions sociales, qu'elle est le fondement de la pratique sociale et que les acteurs y forgent des outils pour récuser les « aliénations historiques ». C'est à sa suite que l'habiter et l'appropriation sont devenus les maîtres-mots que l'on connaît pour qualifier la dimension temporelle des actions mises en œuvre par les habitants pour donner un sens aux espaces de leur vie quotidienne, du logement à la ville. La notion de mode d'habiter se réduit ainsi le plus souvent à la spatialisation des modes de vie, laquelle doit beaucoup également aux engagements intellectuels et politiques des années soixante-dix. On se souvient du slogan « changer la ville, changer la vie », qui indiquait, par sa proposition réversible, que les modes d'habiter pouvaient être non seulement le révélateur, mais le moteur du changement social, dans des laboratoires tels que les villes nouvelles ou la ville neuve de Grenoble.
H. Lefebvre s'était bien gardé de donner des indications méthodologiques aux futurs observateurs de la vie quotidienne qui ont tous tenté des classements, sans que souvent l'on sache de quoi ils rendent compte : pratiques ou usages, modes ou manières, genres ou styles de vie (ou d'habiter). A partir de combien de régularités dans la disposition de l'activité sociale parle-t-on d'usage, se demandait Max Weber ? Quelle condition logique de régularités d'usage forme un mode de vie, questionne aujourd'hui Salvador Juan, qui, pour « fonder l'explication compréhensive de la vie quotidienne », a réalisé une œuvre de clarification théorique sans équivalent [1991, 1995, entre autres]. En trois mots :
1° Il faut s'assurer de l'unité d'observation : tous les gestes de la vie quotidienne ne sont pas des usages, ils doivent être signifiants.
2° Les pratiques ne doivent recouvrir que les gestes individuels, sans contenu normatif, alors que les usages sont des « coproduits de l'action et des institutions.»
3° Le mode de vie représente un ensemble de normes de groupe, alors que le style de vie (selon Pierre Bourdieu [1979]) est une orientation individuelle de l'action – à noter qu'ici, le style de vie, système de pratiques classées et classantes, de goûts et de choix, ne doit pas être confondu avec son homologue, dit aussi sociostyle, inventé par des professionnels du marketing. S. Juan propose de réserver le genre de vie à la mesure de l'écart à la norme ; ainsi, pour des usages formant un mode de vie, le style de vie sera ce qui particularise l'individu, le genre de vie étant la variation de ces usages dans une population homogène.
Le chemin de la rigueur conceptuelle tracé par S. Juan est-il la seule voie possible ? Nul doute qu'un meilleur usage des mots justes aiderait à préciser les notions de stabilité et de changement, ou bien ce qui relève de l'individu ou ce qui est induit par le groupe, mais force est de reconnaître que l'inégale qualité du ciment conceptuel de nombreuses enquêtes ne les empêche pas de tenir debout et d'être admis au panthéon des savoirs. La tradition des disciplines et, surtout, l'orientation de la commande font que les savoirs sociologiques sont plutôt centrés sur les populations ou plutôt sur les espaces. La démarche multiple de l'ethnologie et de l'anthropologie y rend cette distinction non pertinente, bien que l'ethnologie urbaine, comme le rappelle Isaac Joseph [1983] en introduction de l'ouvrage d'Ulf Hannerz, lui-même présentant l'anthropologie urbaine américaine, se veuille ethnologie des citadins et non ethnologie de la ville.
L'habiter des populations
Les grandes enquêtes sociographiques sont nécessaires pour la vue panoramique, donc éloignée, qu'elles offrent de la société, surtout quand elles sont analysées à la lumière d'une problématique, ainsi qu'Yvonne Bernard a procédé en 1988 avec l'enquête Logement de l'INSEE. En se demandant si les pratiques de l'habiter subissaient une homogénéisation massive ou au contraire conservaient des différences sensibles, Y. Bernard [1992] a constaté qu'une transformation majeure, le développement du travail féminin, modifiait la préparation des repas (plus légers) et le lieu de la consommation (la cuisine, de préférence) sans remettre en cause la place du repas du soir dans la vie familiale. Pour les autres enquêtes, la division du travail dans les sciences sociales oriente vers une population, un groupe. Dans les années cinquante et soixante, selon la tradition sociologique, la classe ouvrière fut l'objet d'étude par excellence. La solidarité politique resserrait l'intérêt pour une classe « idéale » par sa forte identité — vécue de l'intérieur et perçue de l'extérieur —, ses traditions morales et éducatives, son mode de vie et ses formes d'habitat typiques. Paul-Henri Chombart de Lauwe [1956], Henri Coing [1966], Michel Verret [1979], puis à leur suite Daniel Pinson [1988], Olivier Schwartz [1990] ont chacun réalisé des enquêtes de référence sur « le monde privé des ouvriers.» Ce titre à double sens d'O. Schwartz indique bien que son investigation est sans doute la dernière du genre, ce qui reste de la population ouvrière ne se reconnaissant plus comme classe et se confondant avec celle des petits et moyens salariés. La culture ouvrière (qui déborde les effectifs des ouvriers proprement dits) se caractérise par ses réponses à la précarité et sa fidélité à un modèle classique de famille conjugale : l'espace ouvrier symbolise l'unité de la famille contre le monde du travail. Le « chez-soi » est un « à-soi » et un « entre-soi », dit O. Schwartz. Le rapport à la famille donne la mesure de la place du logement dans l'éthique de vie ouvrière, ajoute D. Pinson, qui identifie, à côté de la figure ouvrière dominante pour laquelle la maison symbolise l'autonomie dans le mode de vie, une frange ne souhaitant pas voir le logement compromettre d'autres engagements (les vacances, par exemple).
La bourgeoisie est encore loin d'avoir été l'objet d'investigations et d'inspirations équivalentes, tant il est vrai que l'on sait presque tout sur les classes qui ne possèdent presque rien, et réciproquement. On doit à Monique Eleb la première histoire de l'architecture domestique et des mentalités. Les classes privilégiées le sont également dans sa restitution, du fait que les traces de leurs modes d'habiter (plans des habitations, traités d'architecture, manuels de savoir-vivre, etc.) sont plus nombreuses. L'évolution de la distribution des pièces indique l'émergence du « moi », la naissance de la chambre conjugale, la montée de la vie quotidienne en famille, l'anoblissement de la salle à manger. C'est par économie qu'au lendemain de la première guerre, le logement bourgeois s'est modernisé en se rétrécissant [Eleb, 1995]. Depuis, les restrictions apportées à la vie quotidienne de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie par rapport aux fastes passés n'empêchent pas la « classe de loisir » de redoubler les distances sociales par des distances spatiales ; la ségrégation spatiale reste vive tant dans les beaux quartiers que dans les lieux de villégiature, grâce à un protectionnisme urbain efficace [Pinçon, 1996].
Les cadres supérieurs se distinguent des autres salariés par leur mode de vie en évolution [Bernard, 1992], mais peuvent-ils pour autant être définis par leurs modes de vie ? Parce qu'ils ne sont « que » des salariés, à la différence du modèle de référence bourgeois, ils entendent séparer formellement le monde du travail et le monde hors-travail, ce qu'assurent les beaux quartiers en tant qu'espace social, paysager et lieu optimum de la reproduction sociale [Raymond, 1980]. Il en va tout autrement des classes moyennes nouvelles, prétendus inventeurs de nouveaux modes d'habiter (ex.: l'ouverture des espaces du logement et des règles de réception) et redécouvreurs de quartiers anciens réputés authentiques et animés [Bidou, 1984], à la différence des beaux quartiers dont leurs résidents n'attendent qu'une seule chose : qu'il ne s'y passe rien [Grafmeyer, 1991].
L'insuffisance du classement socioprofessionnel à rendre compte des modes de vie, conjuguée à la croissance des ménages solitaires, monoparentaux ou recomposés, a fait émerger d'autres déterminants [Bonvalet, 1988]. La précarisation des emplois et l'éclatement des familles complexifient les usages des logements, quand les loyers sont en hausse mais les revenus en baisse, ou quand les enfants habitent (vivent, en tout cas) alternativement chez leur mère et chez leur père. Ces usages singuliers forment-ils pour autant d'autres modes d'habiter ? La question se pose aussi pour la mesure de la singularité des migrants, dont les pratiques culinaires, les modes de réception ou d'aménagement du logement résultent d'ajustements entre l'expérience vécue et les références locales. Emprunts, transferts, redoublements caractérisent par exemple la conception et l'usage des maisons des Portugais en France et au Portugal [Villanova, 1994], selon un mouvement qui n'est pas foncièrement différent de celui de certains Auvergnats ou Bretons de Paris, eux aussi fiers de leurs différences et hantés par la maison de retour.
L'habiter des lieux
Avant que le « mal des grands ensembles » devienne un « problème de société », des sociologues (Chombart de Lauwe, Paul Clerc) se sont préoccupés, au tournant des années cinquante-soixante, des quartiers collectifs périphériques. Contrairement à ce que l'on a pu dire, passée la satisfaction, dans les premiers mois, de populations ayant connu les pires conditions de surpeuplement et d'inconfort, les germes de la crise future apparaissaient déjà à travers les réponses relatives à l'insonorisation des logements, à l'enclavement des nouveaux quartiers ou à leur sous-équipement.
C'est dans ce contexte de développement massif des grands ensembles qu'en 1966 ont paru Les Pavillonnaires. Henri Raymond et Nicole Haumont y montrent comment le système pratique et symbolique du pavillon offre « une vision ordonnée du monde et de la famille.» Cette œuvre charnière était prémonitoire de l'extension du pavillonnaire dix ans plus tard, notamment sous la forme de nouveaux villages périurbains, où les classes moyennes et supérieures abaissent leurs clôtures pour élever leurs différences. Et pourtant, S. Juan [1991] estime que les « effets purs » de l'habitat sur la vie quotidienne sont dérisoires : les distinctions constatées dans les usages de la maison individuelle et du logement collectif renvoient essentiellement aux origines sociales et aux trajectoires résidentielles.
Mais ce sont les usages du logement collectif qui demeurent les plus connus, surtout son secteur expérimental, véritable théâtre subventionné mettant en scène des architectures censées répondre à de nouvelles aspirations. L'observation de ces logements singuliers, commandée par le Plan Construction et Architecture, renseigne d'autant plus sur le sens commun de l'habiter que celui-ci est contrarié, par défaut d'intimité ou de sécurité, par excès de sévérité démonstrative ou de pauvreté constructive [Léger, 1990 ; Raymond, 1996]. On aurait tort toutefois d'opposer la tradition de l'habitant à la modernité de l'architecte, car l'invention typologique n'est pas avare, parfois, de générosité en volumes intérieurs, lumière, duplex, ou terrasses sans équivalent dans le logement standard, ancien ou moderne. Toutefois, cette modernité feint toujours d'ignorer l'arrière de la vie domestique et ses pratiques banales (les soins du linge, le rangement, le bricolage). Les tâches ménagères, admises maintenant comme production domestique, au même titre que l'auto-construction et le bricolage, sont davantage qu'une entrée de service pour la compréhension des différences hommes-femmes dans le logement observées par Daniel Welzer-Lang et Jean-Paul Filiod [1991]. C'est toutefois Jean-Claude Kaufmann qui les aura hissées au rang d'objet d'une sociologie du quotidien. Après avoir énoncé que le « repli domestique » pouvait être aussi un redéploiement de la personnalité et même exprimer une vertu démocratique, J.-C. Kaufmann ne vise pas tant dans les gestes du ménage l'appropriation du logement que la fondation d'une théorie de l'action ménagère [Kaufmann, 1997]. A la différence de la banalité du travail ménager, celle du décor et des objets familiers ne frappe pas ceux-ci du même discrédit ; au contraire, et avant d'intéresser Jean Baudrillard en 1968, l'étude de leur système appartient à la tradition ethnologique et à ses terrains exotiques ou ruraux. Structuration du monde, langage, les objets sont aussi, pour Martine Segalen [1993], des « créations familiales » qui reflètent les stratégies de carrière, de résidence, de projet familial.
Habite-t-on la ville ?
Passer du logement à la ville suppose un changement d'échelle et d'objet, si l'on admet que la ville, ce sont les citadins. Limitées, dans le logement, au groupe domestique et au voisinage, les formes de la sociabilité s'élargissent alors aux cercles éphémères ou stables des rencontres et, surtout, de la parenté, dont Michael Young et Peter Willmott avaient remarquablement décrit dans les années cinquante le rôle structurant dans les manières d'habiter un « village » (le quartier de Bethnal Green) dans une ville (Londres) [Young et Willmott, 1957]. En France aussi, les ouvriers et les minorités pauvres ou immigrées ont, outre Chombart de Lauwe, Coing et Schwartz, mobilisé les ethnologues : Colette Pétonnet sur l'espace et le corps, le travail et l'argent dans le sous-prolétariat [1985], Gérard Althabe [1984] sur les transformations sociales induites par les rénovations urbaines et industrielles, Pierre Mayol sur les manières de se tenir dans un quartier populaire à forte identité, la Croix-Rousse à Lyon [Giard et Mayol, 1980], etc. A Lyon également, Yves Grafmeyer [1991] renouvelle l'étude des sociabilités urbaines par des approches contextuelles combinant les méthodes de la sociologie et de l'ethnologie. En considérant que le logement et l'immeuble sont un des points d'appui des sociabilités dont le quartier et la ville forment le contexte, Y. Grafmeyer observe les « situations de coprésence » (avec les voisins, les commerces, les espaces publics, les écoles, etc.) en relation avec les trajectoires des habitants et les statuts des immeubles.
C'est par opposition au fonctionnalisme des fonctionnaires et des opérateurs urbains que des sociologues avaient voulu montrer la nécessité de l'appropriation dans l'accomplissement de l'habiter, si bien que la plupart des études sur les modes d'habiter le logement sont toujours attachées, d'une corde plus ou moins longue, au concept d'appropriation. Or I. Joseph, « passeur », avec Y. Grafmeyer, de l'École de Chicago en France, estime que la métaphore de l'appropriation demeure encore pour plus d'un sociologue français un obstacle épistémologique à l'étude de la ville ; l'expérience urbaine est une rencontre, chacun accédant à un rôle en fonction de situations. L'étendue du champ urbain, entre socio-ethnologie de l'appropriation et sociologie hors-sol interactionniste, risque ainsi de se voir caricaturée en sociologies du repli domestique et sociologies de l'ouverture, suivant le fameux mot de Robert Park, fondateur de l'école de Chicago (« l'air de la ville rend libre »).
Demain la domus, l'espace et le temps
De même que la face cachée de la maison demeure inconnue tant que l'on n'en a pas fait le tour, la « découverte » du changement ne dit pas toujours si le changement est celui du regard ou celui de l'objet. Aujourd'hui, tout un faisceau de recherches change d'optique en élargissant l'espace et le temps de l'habitation. La prise en compte de l'histoire des ménages, des rapports entre les générations [Bonvalet et Gotman, 1993], des relations avec les résidences secondes et les maisons de famille, des mobilités entre ces résidences et avec les lieux du travail, redéfinissent l'espace et le temps résidentiel pour lesquels sont réactivés des concepts, tel celui de la domus, qui rend compte de l'implication croisée et durable des espaces, des acteurs et des investissements socio-économiques dans l'habitat [Bonnin, 1990].
Mais la discussion sur les instruments d'observation ne doit pas détourner des transformations dans les pratiques. La frontière entre temps de travail et temps domestique devient indécise ; de nouvelles formes de travail intellectuel après le travail se développent, quand il ne s'agit pas du télétravail. Gardons l'œil sur ce dernier croisement, discutable, entre la privatisation du travail et la « publicisation » du logement : pour leur double journée les femmes sont désormais à demeure.
Bibliographie
ALTHABE Gérard, LEGE Bernard, SELIM Monique (1984), Urbanisme et réhabilitation symbolique, Ed. Anthropos, Paris.
BERNARD Yvonne (1992), La France au logis. Etude sociologique des pratiques domestiques, Ed. Mardaga, Liège.
BIDOU Catherine (1984), Les aventuriers du quotidien. Essai sur les nouvelles classes moyennes, PUF, Paris.
BONNIN Philippe (1990), « Produire la domus : une affaire de famille. Niveaux et formes d'investissement des familles dans l'espace domestique », Sociétés contemporaines, n° 5, p. 145-161, L'Harmattan.
BONVALET Catherine, MERLIN Pierre [eds] (1988), Transformation de la famille et habitat, Travaux et documents, cahier n° 120, PUF-INED.
BONVALET Catherine, GOTMAN Anne [eds] (1993), Le logement, une affaire de famille, L'Harmattan, Paris.
BOURDIEU Pierre (1979), La distinction. Critique sociale du jugement, Ed. de Minuit, Paris.
CHOMBART DE LAUWE Paul-Henry (1956), La vie quotidienne des familles ouvrières, Ed. du CNRS, Paris.
COING Henri (1966), Rénovation urbaine et changement social, Les Ed. ouvrières, Paris.
ELEB Monique, avec Anne DEBARRE (1995), L'Invention de l'habitation moderne. Paris 1880-1914, Hazan et Archives d'architecture moderne, Paris, Bruxelles.
GIARD Luce, Mayol Pierre (1980), L'invention du quotidien, t.2, Habiter, cuisiner, UGE, coll. 10/18, Paris.
GRAFMEYER Yves (1991), Habiter Lyon. Milieux et quartiers du centre-ville, Ed. du CNRS-Presses univ. de Lyon, Lyon.
JOSEPH Isaac (1983), Présentation de Ulf Hannerz, Explorer la ville. Éléments d'anthropologie urbaine, Ed. de Minuit, Paris.
JUAN Salvador (1991), Sociologie des genres de vie. Morphologie culturelle et dynamique des positions sociales, PUF, Paris.
JUAN Salvador (1995), Les formes élémentaires de la vie quotidienne, PUF, Paris.
KAUFMANN Jean-Claude (1997), Le cœur à l'ouvrage. Théorie de l'action ménagère, Ed. Nathan, Paris.
LEGER Jean-Michel (1990), Derniers domiciles connus. Enquête sur les nouveaux logements 1970-1990, Ed. Créaphis, Paris.
PETONNET Colette (1985), On est tous dans le brouillard. Ethnologie des banlieues, Ed. Galilée, Paris.
PINÇON Michel, PINÇON-CHARLOT (1996), Grandes fortunes. Dynasties familiales et formes de richesse en France, Ed. Payot et Rivages, Paris.
PINSON Daniel (1988), Du logement pour tous aux maisons en tous genres, Plan Construction et Architecture, coll. Recherches, Paris.
RAYMOND Henri (1996), « L'usage du logement. Traduire ou trahir », Cahiers de la recherche architecturale, n° 37, Ed. Parenthèses, Marseille, p. 19-24.
RAYMOND Henri et al. (1980), Les cadres supérieurs de l'industrie : mode de vie et habitat, Institut de sociologie urbaine, Paris.
SCHWARTZ Olivier (1990), Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, PUF, Paris.
SEGALEN Martine, LE WITA Béatrix [eds] (1993) , « Editorial », Chez-soi. Objets et décors : des créations familiales ? Autrement, série Mutations n°137.
VERRET Michel (1979), L'espace ouvrier, Ed. Armand Colin, coll. U, Paris ; rééd. L'Harmattan, Paris, 1995.
VILLANOVA Roselyne de, avec la collab. de Rabia BEKKAR (1994), Immigration et espaces habités, CIEMI-L'Harmattan, Paris.
WELZER-LANG Daniel, FILIOD Jean-Paul (1991), Les hommes à la conquête de l'espace... domestique. Du propre et du rangé, VLB éditeur, Montréal.
YOUNG Michael, WILLMOTT Peter (1957), Family and Kinship in East London, Routledge and Kegan Paul, Londres ; trad. fr. par A. Gotman (1983), Le village dans la ville, Centre Georges-Pompidou, Paris.
Si vous souhaitez acquérir le livre
Logement et habitat, l'état des savoirs est disponible à la Librairie Le Genre urbain ou bien sur Amazon